
Ale
BARBAR’O’RHUM - "Journal de B’O’R"
Si votre serviteur se demande ce que donnerait un album de gros metal relatant des aventures historico-légendaires liées à la piraterie, tout en étant plus sérieux et plus lourd… chose qui serait tout à fait envisageable pour un groupe français, pays fortement attaché aux histoires de trésors, de flibuste et de coups de sabre, il n’aura pas sa réponse cette fois ! Et en même temps, il y a un petit quelque chose, un petit goût de « revenez-y » qui place le line-up toulousain un peu à part des Alestorm ou Rumahoy, qui ont déjà bien poncé le « genre » au point de laisser l’impression d’une blague un brin trop longue. Non pas que Barbar’O’Rhum (qu’on nommera BOR à partir de tout de suite) mette le fun au placard, bien loin de là. Suffit d’écouter « Pénurie de Rhum » ou « Frères de Bitte » (sans commentaire !) pour s’en assurer, clairement, il y a une tradition du chant populaire, teinté de grivois et qui donne envie de rejoindre la fête. Mais véritablement… Il y a autre chose. Peut-être est-ce le caractère très cosmopolite de leurs titres, qui attribue vraiment de la couleur à un album riche de onze titres ? Peut-être est-ce le fait de chanter en français, donnant une proximité forcément subjective, mais néanmoins sincère qui confère aux titres et à leurs paroles une aura de sympathie bienveillante ? Peut-être en outre est-ce l’étonnante maturité de cet album, comportant de nombreux morceaux très longs, où les instruments ont bien le temps et l’opportunité de se montrer, de s’exprimer. Loin de nous l’idée de prétendre que les autres groupes n’ont pas à cœur certains choix artistiques pertinents et un travail certain en plus de leur volonté de proposer des titres funs et « à boire », mais chez BOR… C’est poussé à son paroxysme. C’est fun, mais nullement parodique (encore que, n’en déplaise aux mauvaises langues, pour bien parodier… il faut bien connaître le sujet de base). Et les notes de l’équipage sur la conception, l’inspiration des chansons en atteste amplement : il y a eu de la réflexion derrière tout ça, beaucoup de références… et un désir de diversité de plaisir d’écoute, par-dessus la simple autodérision et l’invitation à se murger. Mention spéciale d’ailleurs pour le morceau qui clôt l’album, « Les P’tits Rafiots », qui propose « La rencontre improbable entre une Comptine française sur le thème maritime, un morceau de Musique classique d’Antonio Vivaldi et deux Jigs irlandaises très connues du milieu pour un final explosif » … pour une fois, le groupe fait pratiquement sa propre critique, mais ce serait difficile de mieux le qualifier, et d’expliquer en quoi c’est si bien ! Je n’aurai pas forcément cru rédiger ma plus longue critique sur du pirate metal et encore moins sur un groupe qui m’était encore inconnu, mais rien que pour m’avoir remémoré les années Naheulband, Fatals Picards et Celkilt… La casquette du chroniqueur se voit balayée par une bourrasque. Bravo, les gars, vous êtes peut-être les meilleurs dans ce que le genre produit actuellement.
THE NATURAL DISASTERS - "Tormenta"
Avec un nom pareil, on aurait pu s’attendre à un groupe d’indie rock bien sympatoche, ou alors, un du kepon bien vénère et caustique, mais il n’en est rien. Au contraire, c’est vraiment une petite perle sombre que nous livrent les danois pour ce premier album (un premier EP était sorti il y a pratiquement deux ans). C’est au demeurant un cas à part en termes d’obscurité, puisque les paroles ne font ni un étalage de dépression, ni d’une multitude d’horreurs. Et la musique elle-même ne parait pas lourde ou oppressante. Cela provient d’ailleurs, des voix peut-être. Il faut dire que ce duo masculin-féminin est particulièrement réussi, et on regrettera juste qu’ils n’apparaissent jamais ensemble. Pour l’aspect instrumental, on croirait entendre des relents post-rock (ou post-metal, pour les plus tatillons), tout en ayant un côté très pêchu, énervé… Clairement loin du profil contemplatif que l’on attribue souvent au genre. De quoi retrouver le côté goth ? Oui ! en atteste un titre tel « Mountain of Despair », très mégalo, presque cataclysmique. Alors qu’un titre comme « Lay Down » correspond plus à ce côté post-rock, plus tendre, lancinant… Nous accordant presque une pause, un instant d’accalmie en plein milieu de l’album. Presque… Car cela reste caverneux, lointain, quasi hors du temps et du monde. On traverse beaucoup d’émotions sur cet album, et ce dès le titre d’ouverture « Where’s The Thunder » qui pourrait presque passer pour un petit morceau de pop-rock des années 90 si ce n’était pour cette guitare éthérée, nous transportant ailleurs. Indubitablement, nous avons là un album réussissant l’exploit d’être créatif et original tout en étant accessible et agréable pour (pratiquement) toutes les oreilles. Si les « catastrophes naturelles » (Tormenta signifiant « tempête ») ne sont pas aussi abrasives que prévu, elles méritent amplement votre attention.
TERRA ATLANTICA - "Age of Steam"
Si cela faisait longtemps que votre serviteur n’avait plus chroniqué de Power, il suffit d’en avoir entendu une fois dans sa vie pour remarquer que Terra Atlantica coche toutes les cases. Rien de neuf donc ? Pas vraiment… Mais rien de vraiment fade ou de mal-fait non plus, au contraire ! Oui, ça parle de mythologie en chant clair. Oui, ça offre des bridges aussi nombreux que techniques, où les riffs pleuvent. Et oui, il y a un côté délicieusement cheesy totalement jubilatoire. Et n’est-ce pas finalement en outre pour ça qu’on aime le Power ? On retrouve d’ailleurs moins le côté suédois et davantage l’école allemande, à la Blind Guardian ou Helloween. Logique. L’aspect théâtral, grandiloquent… presque classique qui s’en dégage. Même si Terra Atlantica semble varier les plaisirs en proposant parfois des titres plus hard, plus posés ou avec des atmosphères différentes (alors que le groupe continue d’imaginer l’Atlantide, cette fois-ci de manière anachronique, telle qu’elle serait au XIXe Siècle : certains titres ont plutôt une ambiance fantasy ou médiévale). Que dire de plus ? Pas grand-chose. L’album fait le café, le fait très bien et plaira assurément aux amoureux de bon Power bien fait. C’est varié, c’est technique, c’est épique, c’est lyrique… Le groupe aime ce qu’il fait et fait ce qu’il aime. Et on ne leur en tiendra pas rigueur, loin de là.
TARAH WHO ? - "64 Women"
Explosivement engagée, la musique de Tarah Who ? (du nom de la front-woman, pour la petite info) dispose de cet écrin de créativité permis non seulement par la sortie d’un premier EP (on se cherche toujours un peu plus qu’après vingt ans de carrière), mais aussi, et surtout par leur style de prédilection… qui choisit justement de faire fi des codes établis et de finalement proposer à peu près ce qu’on veut de musicalement intéressant et audacieux. Comme toujours, on ne prétendra ni que le groupe réinvente un genre entier, ni que ce qu’il soumet n’est que bouillie sonore. Au contraire, on sera flatté de constater qu’il est sans cesse possible de surprendre en empruntant des sentiers que l’on n’a plus foulés depuis longtemps, et que sur un seul et unique EP, on peut avoir des titres aux ambiances très marquées. « Copycat » est une petite bombe d’énergie, « Numb Killer » est un plaidoyer rageur tandis que « Hurt » se veut plus posé et émotionnel. L’ensemble révélant en tout cas l’intégralité des talents du duo. Car oui, il n’y a que deux têtes pensantes derrière le projet ! Mais elles sont très clairement d’une versatilité à toutes épreuves et d’une patate exemplaire. Ce premier EP a tout d’une carte de visite, sur presque tous les points : versatilité, puissance, habileté d’écriture et personnalité. Il n’est pas forcément facile d’accès, mais à défaut de se savourer comme une petite praline, on dira qu’il s’avale tel un shot qui retourne le bide. Faites-en ce que vous voulez !
STÄLKER - "Black Majik Terror"
Outch… Avoir l’impression d’écouter une parodie alors que ce n’est pas du tout le cas, c’est clairement une critique très rude. Et pourtant, on peine à trouver des éléments vraiment intéressants dans la musique de Stälker. Même ce qui n’est pas trop mal, comme les bridges ou les thématiques développées, me semble finalement assez convenu et sans éclat. Sur un album d’à peine neuf titres, on a souvent le sentiment que les morceaux sont relativement interchangeables, si ce n’est parfois pour une intro plus atmosphérique comme sur la plage tutélaire ou le côté pesant, presque lugubre sur « The Cross ». On aurait peut-être aimé un peu plus d’audace et de variété de la sorte, quitte à perdre un brin ce côté pétaradant et « speed » stricto sensu. Non pas qu’il ne soit pas agréable de se voir secouer dans tous les sens par la musique, mais un peu de diversité fait toujours plaisir. Pour moi, le gros point noir, qui passera forcément par plus ou moins de subjectivité, reste le chant de Daif… Une voix éraillée et tranchante est souvent de rigueur dans le Speed, et plus besoin de prouver que partir dans les aigus donne des résultats habituellement très convaincants, mais ici, cela devient rapidement lassant… Et provenant d’un fan absolu de Judas Priest, ce n’est pas rien de le dire. Loin de nous l’idée de remettre en cause le talent brut du chanteur (tenir un album entier en hurlant de la sorte est déjà une prouesse des plus respectables !), mais moduler légèrement son style et faire preuve d’un peu plus de parcimonie dans l’utilisation des aigus serait un gros plus à l’avenir, peut-être justement, à réserver en tant que climax ? C’est finalement bien dans la retenue que brillent ces poussées de puissance après tout… On n’imaginerait pas tout l’album « Painkiller » hurlé avec la même intensité ! Un constat assez rude pour un résultat assez décevant, presque énervant… Notamment en rajoutant que chaque membre dispose d’une petite expérience au sein de groupes variés. Mais Stälker est encore très jeune, et un faux pas ne doit certainement pas signer le terme d’un projet au terreau convenable. Il y a de la place pour du Speed Old-School et les bases sont fixées. Plus qu’à trouver le bon équilibre entre hommage et recherche de sa propre identité.
CALAROOK - "Surrender or Die"
Un avantage considérable qui marque d’emblée lorsque l’on écoute Calarook c’est qu’ils se démarquent du genre déjà saturé (car très spécifique) du pirate metal. Comment ? Par un chant plus costaud, plus agressif, faisant même du pied au growl parfois. Par des titres très variés également, beaucoup moins festifs que ce que l’on peut retrouver chez Alestorm ou Rumahoy par exemple. Ici, ça tape souvent dur, ça laisse pleinement la place aux instruments (les bridges sont souvent longs et très réussis) et surtout : les paroles parlent davantage de personnages, de créatures ou de batailles de légendes (en mode folk ou power plus que « pirate » stricto sensu). Rassurez-vous, il y a quand même quelques titres qui traitent de biture et de sujets plus loufoques… On reste sur un style très fantasmé, très propice au fun et aux folles histoires. C’est avant tout une question de présentation. Que ce soit « The Undying Sailor » qui clôt l’album avec grand fracas, « Paul the Parrot » pour la touche plus amusante ou encore l’épique plage tutélaire, y’a clairement matière à non seulement passer un bon moment décomplexé, mais surtout… à apprécier, sans une once d’ironie, certains titres de l’album pour leur qualité et leurs refrains aussi bêtes qu’inoffensifs (et facile à mémoriser). Aucune attaque contre le genre : c’est sa force, après tout. Quant à Calarook, et bien qu’il paraisse difficile de citer le moindre pirate suisse, ils ont clairement tout compris. Car non contents de proposer un premier album de bonne facture, ils prouvent qu’il est possible de réinventer un style trop souvent perçu comme une blague… Peut-être aussi parce qu’il n’avait jusqu’à présent que trop rarement pris le risque de montrer qu’il pouvait être plus que ça.
THE LAWRENCE ARMS - "Skeleton Coast"
Une nouvelle sortie du trio est toujours une petite révolution dans le genre aujourd’hui teinté de nostalgie juvénile qu’est la pop-punk. En effet, ils aiment prendre leur temps entre chaque album et chacun ira de sa petite théorie pour l’expliquer : faire languir les fans, prendre le temps de peaufiner leur travail… Ou simplement l’envie de se reposer et de prendre le temps de faire les choses bien. Peu importe au final. L’idée reste que même en arrivant un peu sur le tard, The Lawrence Arms demeure un groupe représentant dignement le deuxième âge d’or du punk, plus commercial certes, mais toujours aussi pêchu et énergique. Et plutôt que de réinventer le genre, c’est presque sous des allures de best-of que « Skeleton Coast » débarque dans nos tympans. On croirait parfois entendre plusieurs chanteurs selon les morceaux ! Et c’est cette versatilité qui fait tout le sel de cette nouvelle mouture. Difficile de dresser des comparaisons entre « Ghostwriter », « Last Last Words » ou encore « Lose Control ». Le groupe nous transporte au sein de plusieurs atmosphères, plusieurs émotions. Et si on peut regretter un manque de grosse colère, ce qui se répercute aussi sur les thèmes de l’opus (plus poétiques que réellement revendicatifs), ça donne aussi un formidable contrepied à un genre qui gueulait tantôt sur l’oppression, tantôt sur les problèmes de l’adolescence… C’est que les punks aussi, peuvent faire preuve de lyrisme !
MERCURY CIRCLE - "The Dawn of Vitriol"
Que ce drôle de melting pot de genres ne vous effraie pas : il est finalement assez peu explicite sur ce que représente vraiment le nouveau projet de Jaani Peuhu, déjà bien rodé grâce à ses groupes Iconcrash et Swallow The Sun. Fort de ces expériences, et de son propre aveu, il envisage de proposer sa propre version d’un « nouveau Doom » avec Mercury Circle. Pari réussi ? Carrément ! Même si on retrouve davantage d’éléments de post-rock que de synth proprement dit (ne vous attendez pas à du Perturbator, ni à du doom hyper lourd et macabre !). Seul le chant nous rappelle que nous ne sommes pas dans du post-rock stricto sensu. L’album commence, quant à lui, de façon mystique, presque hors du monde, avec « Oil of Vitriol »… avant de s’emballer sur le dernier tiers du morceau. Le titre suivant, « The Beauty of Agony », est plus bavard, mais tout aussi grandiloquent, tandis que « Black Flags » propose une accalmie des plus mélancoliques, presque trip-hop en vérité ! Sans doute le titre le plus surprenant de l’EP. « The Last Fall » aurait pu, bien justement, être le morceau de clôture avec son rythme lancinant, mais il précède en réalité « New Dawn » au titre presque antonyme, pour une atmosphère et une construction somme toute similaire. Une belle petite collection qui vous tiendra en haleine près d’une demi-heure (et oui, on parle de morceaux assez longs et structurés !) Mentionnons pour finir l’artwork de l’EP, aux airs un peu vaporwave et qui doit être du plus bel effet en format physique. Une très agréable surprise !
MARTYR ART - "Through Soundwaves Vol.2"
Sachant qu’il est toujours compliqué d’occulter la moindre comparaison, la sortie d’un album de covers est un exercice d’autant plus ardu. Il s’agit ici d’un projet assez singulier développé par Joe Gagliardi, seul capitaine du navire Martyr Art depuis 2004. Il envisage en effet de sortir 4 EPs de la même trempe que ce deuxième opus. Pari réussi ? On saluera en tout cas l’audace de transposer en solo des titres tantôt oubliés ( « Love Like Blood »), tantôt que l’on aurait difficile imaginé « industrialisé » ( « Blinding Lights » de The Weeknd). Mais le constat est en demi-teinte… Les instruments manquent de patate et le chant d’émotion. On pourrait même, cyniquement, dire que sans la présence de quelques éléments electro, les morceaux s’éloignent assez de l’indus des grands maîtres que sont Ministry, Skinny Puppy, NIN… Un comble alors qu’il reprend un mashup de « The Perfect Drug» et « Gave Up » ! On dira au moins, non sans malice, que la saveur est en tout cas très différente, et c’est finalement ce qu’on recherche dans une bonne cover ? Elle ne sera pratiquement jamais meilleure que l’originale, et n’en a pas non plus la prétention. Elle cherche modestement à rendre hommage, et parfois… Sublime d’une tout autre manière un titre. On ne reprochera pas à Martyr Art d’avoir tenté le coup. Et si sa reprise du thème de Buffy Contre les Vampires (oui oui !) est un gage de son talent, alors ne doutons pas une seconde qu’il soit capable de grandes choses. Espérons surtout que ce quadruple EP ne se révèle pas être un projet trop gourmand.
DELTA TEA - "The Chessboard"
On pourrait sans crainte qualifier ce premier de Delta Tea de véritable « OVNI » que ça leur ferait certainement plaisir ! Amoureux de science-fiction, ils présentent leur musique comme une bande-son de Space Opera Rock. Et on ne pourrait leur donner tort à l’écoute des sonorités cosmiques sur « Outro » et un côté presque synthwave sur la fin de « Share ». Pour autant, ce serait encore trop simple, eux qui entendent nous décrire toute une épopée par le simple biais de leurs instruments. Ces derniers vont dans tous les sens, presque littéralement, et chaque titre s’étire en longueur pour passer par presque tous les rythmes, toutes les émotions, toutes les techniques. Il s’agit d’une musique très riche, très complexe, mais aussi très étonnante. Les titres commencent souvent en douceur, pour finir avec fracas… Sonnant presque comme des thèmes grandiloquents de boss final d’un jeu vidéo proposant moult aventures épiques. Même la dégaine suave de notre quatuor surprend, tant elle laisse plutôt à deviner un univers victorien (certains diront Steampunk) plutôt que réellement SF. Leur artwork, le nom du groupe ou encore les titres de chacun des morceaux viennent parfaire l’ensemble, attestant de ce côté cryptique, étonnant, intriguant. Tout en proposant des titres qui filent malgré leur relative longueur. Une musique très facile d’approche tout en n’ayant rien de commun. On ne dira peut-être pas que Delta Tea s’invente un genre (ha ha), mais ils proposent en tout cas quelque chose de sacrément original, avec une identité marquée. Et ça, ça fait du bien.
BLUE ÖYSTER CULT - "45th Anniversary - Live in London"
Alors qu’ils ont depuis dépassé leurs cinquante ans de carrière, voilà qu’un des lives célébrant leurs 45 ans refait surface. Et on ne s’en plaindra pas : si on bouffe du B.Ö.C. par poignées depuis quelques mois, c’est toujours un régal de redécouvrir leurs lives, toujours plein de surprises malgré la longévité plus qu’honorable du groupe. En effet, comment ne pas s’émerveiller devant ces pures démonstrations de talents sur « Cities on Flame With Rock’n’Roll » ou « Then Came the Last Days of May » ? Toutes les deux se prolongent pendant de longues et délicieuses minutes que l’on ne retrouve pas sur les versions originales… Une tradition du groupe, certes, mais qui varie pratiquement à chaque concert. Pour notre plus grand plaisir. De même, si le duo « Godzilla/Don’t Fear The Reaper » est immanquable, on apprécie toujours leurs introductions… brassant la hype même pour celui qui l’écoute en différé ! Cette version de DFTR est de très bonne facture en plus, on ne s’en plaindra pas. Enfin, au niveau de la setlist, elle est exemplaire : la première moitié se compose plutôt de titres plus obscurs, pas forcément inconnus, mais certainement moins communs aux yeux des non-initiés. La seconde moitié s’inscrit davantage dans les classiques, mais tout le concert est joué avec beaucoup de passion et de ferveur. Y’a pas à dire… « Buck’s Boogie » donne toujours autant de sueurs froides à votre serviteur ! Une fois encore, il s’agit d’un album pas vraiment incontournable pour l’auditeur lambda…est une énième petite perle pour l’amoureux de B.Ö.C.
CAPTAIN BLACK BEARD - "Sonic Forces"
Si avec un tel nom vous vous attendiez à du pirate metal, sans doute que le fait que le groupe soit suédois sera un meilleur indice sur la musique qu’ils entendent déployer. En effet, une fois n’est décidément pas coutume, nous voilà encore face à un groupe de hard rock bien cheesy venu de Suède. Mais ce côté kitsch (pleinement assumé, au cas où la Pontiac sur la pochette n’était pas suffisamment équivoque !) en fait sa plus grande force, et catapulte directement Captain Black Beard aux côtés de leurs compatriotes du Night Flight Orchestra. Avec des titres cosmiques, puissants et diablement efficaces pour nous rester dans la tête, la musique du quatuor n’est pas qu’une énième ode à une période passée. Elle ne pioche pas des éléments, visuels comme thématiques, sortis tout droit des 80s. C’est carrément la décennie entière que le groupe étend sur les dix titres, non sans un certain panache… Et non sans pléthore de synthés, de paroles épiques et de titres fleurant bon les teen movies et la SF de cette époque (« Midnight Cruiser »… ça fait déjà voyager avant même de l’écouter, non ?). Alors certes, faudra apprécier le côté un peu niais des jeunes amoureux de « Young Hearts », ou le refrain un peu facile du néanmoins magistral « Disco Volante ». Mais avec une plage tutélaire comme « Sonic Forces », sortie tout droit d’un dessin animé à la « Ulysse 31 » ou « Jayce, conquérant de la lumière »… On leur pardonne tout. On pourra se plaindre que la nostalgie donne une image tronquée de l’époque visée. Mais avec des albums comme ça… Comment avoir envie de sortir de sa Delorean ?
BLUE ÖYSTER CULT - "Curse of the Hidden Mirror"
Il existe une forme d’injustice qui condamne certains albums, souvent loin d’être mauvais, mais sortant bien après le magnum opus d’un groupe et faisant donc tomber lesdits albums dans l’oubli… Le dernier album de BÖC en est un triste exemple. Car oui, l’histoire est connue : après des ventes décevantes, le quintet s’est gentiment fait éjecter de son label et n’a plus rien sorti depuis. De quoi percevoir « Curse of the Hidden Mirror » comme l’album de la honte ? Certainement pas… Cette redécouverte presque vingt ans après atteste que le groupe n’était clairement ni en perte de vitesse ni à court d’idées. Les titres groovent sévères et il y a une belle alternance de morceaux plus softs, portés par la voix posée d’Eric Bloom… Et d’autres titres nettement plus hargneux, montrant tout le savoir-faire de Buck Dharma, véritable colosse infatigable et pilier de nombreux titres cultissimes du groupe. Mais là où ça coince, maintenant comme à l’époque, c’est par un manque d’éclat. Un manque de vraies perles. Les titres mythiques du groupe se comptent par dizaines : Buck’s Boogie, Astronomy ou Sinful Love (pour éviter sciemment les plus évidents). Mais ici, aucun ne se démarque réellement, malgré le talent de l’écrivain John Shirley (déjà présent sur l’album « Heaven’s Forbid ») et dont les thématiques s’imbriquent parfaitement avec celles du groupe. Pourtant, les chansons « The Old Gods Return », « Stone of Love » ou « Eye of the Hurricane » ne feraient pas tache au milieu d’une bonne playlist. Tout comme l’album mérite amplement de faire partie de la riche discographie du groupe. Simplement, il est rare pour un artiste de finir mieux qu’il n’a commencé. Et déjà à l’époque, la formule classique du BÖC se faisait quelque peu vieillissante. Efficace, mais doucement éculée. Doit-on craindre l’album à venir cette année ? Rien n’est moins sûr, au contraire ! Ce retour, presque inespéré, ne peut que nous faire espérer le meilleur. Un ultime feu d’artifice de l’un des plus grands groupes du genre. Et cette ressortie de leur dernier né, boudé et mal-aimé, n’est qu’une occasion supplémentaire de redécouvrir un album loin d’être dénué d’intérêt. Dernier petit reproche : on aurait peut-être aimé un ou deux petits bonus en l’honneur de cette ressortie. Mais tant pis… Le fait d’expérimenter onze titres, sans doute pour la première fois pour la plupart, est déjà un beau cadeau en soi.
BLUE ÖYSTER CULT - "iHeart Radio Theater N.Y.C. 2012"
Nouvel album live pour les vétérans de Blue Öyster Cult, et quel concert ça devait être ! En plus d’avoir une qualité impeccable, la setlist est des plus alléchantes… tant pour les petits nouveaux que pour les aficionados ne parvenant toujours pas à se lasser de « Don’t Fear The Reaper » (peut-être dans l’une de ses meilleures versions ici d’ailleurs). En effet, on y retrouve des titres moins cultes, mais tout aussi bons comme « The Vigil » sorti sur l’album Mirrors (en 1979 tout de même !) ou le plus doux et onirique « Shooting Shark » et son synthé langoureux ! Non, les titres les plus porteurs se retrouvent à la toute fin, avec bien sûr « Godzilla », ou le mythique et cosmique « Black Blade », injustement boudé à sa sortie en 1980 et depuis l’un des immanquables de la formation. Mais n’attendez pas de ce modeste onze-titres un goût d’inachevé ou une sensation de trop peu. Que du contraire, dans la plus pure tradition d’alors, la vaste majorité des morceaux se permettent dans leur seconde moitié de groover sévère, remisant les paroles pour une démonstration de force entre les différents zickos. Un classique du hard rock de l’époque, qui se retrouve toujours sur les albums ? Oui… Mais pas que ! « Cities On Flame With Rock And Roll » se garnit ainsi de près de 2,30 minutes en plus ! Idem pour « Don’t Fear The Reaper » et ses deux minutes d’outro supplémentaires… et une plus sage demie-minute pour « Golden Age of Leather ». Et c’est peut-être ce qui sépare le mieux cet album d’un simple énième best of du groupe : rien ne fait plus plaisir que voir des rockeurs ayant déjà tout fait, se permettre d’encore se surpasser. Et voir leur personnalité transparaître entre chaque titre est également une friandise fort appréciable. Vous savez à quoi vous attendre… Et c’est exactement pour ça que cet opus en vaut, une fois de plus, pleinement le coup !
TURMION KÄTILÖT - "Global Warning"
Dans le monde très germano-américain de l’indus’, Turmion Kätilöt fait presque office de curiosité. Vocals en finnois, volontiers expérimentateurs dans leurs sonorités et proposant des tempos plus rapides que leurs homologues aux thèmes plus martiaux ou plus sombres… ce qui n’empêche pas le groupe de déployer une esthétique et des thématiques bien trash, bien sûr. Plutôt productifs (on parle de six albums en dix ans quand même !) et avant-gardiste, on a l’impression d’avoir un TK un brin moins vénère et péchu, mais beaucoup plus lourd. Le plus gros reproche que l’on puisse faire, c’est de n’avoir qu’assez peu de titres marquants, malgré leurs excentricités. Oui, l’intro sur un air de tango de « Mosquito à la carte » est sympa, mais le reste du morceau est plutôt classique. Oui, le hook sur « Ikävä » est diablement efficace, mais cela ne fait pas tout. À titre personnel, seul le single « Kyntövuohi » est parvenu à capter l’attention, et à s’insérer profondément parmi les classiques du groupe. Un album médiocre donc ? Pas du tout, simplement un opus moins incontournable. Mais il plaira assurément aux amoureux du groupe autant que d’indus. Ils y retrouveront tout ce qui fait le sel du groupe.
POLTERGEIST - "Feather of Truth"
Déjà actifs lors de l’âge d’or du Thrash dans les 80s, les Suisses de Poltergeist cultivent un curieux mélange de Thrash et de Power, avec éventuellement quelques relents Heavy proposés dans le lot. En ce sens, on pourrait être amusé de voir sur un même opus un titre nommé « The Godz of Seven Rays » et un autre au sobriquet quasi-Glam « Saturday Night’s Allright for Rockin’ ». Ne vous y méprenez pas cependant : l’album traite davantage de concepts et de mythes que de guerre ou de problèmes sociétaux… Sans s’enfoncer pieds joints dans le lyrisme mythologique si cher au power (et contrairement à ce que la jaquette laisserait croire… quoiqu’on ne cracherait pas sur un album-concept sur l’Égypte Antique). Quoiqu’il en soit, Poltergeist déploie une solide charpente thrashy sur l’ensemble des titres qui, bien que solide et ayant fait ses preuves, nous laisse un peu sur notre faim. Nous dirons qu’elle manque de fulgurances plus que d’efficacité. On aurait aimé plus de riffs distordus, des bridges plus longs ou un chant plus énervé. Quelque chose de peut-être un peu moins pris dans un étau en somme ! Car malgré des chorus aussi simplistes qu’efficaces (« Ambush » ou « Megalomaniac » surtout, reposant pratiquement sur un seul mot… mais qu’on crie volontiers en même temps que A.Grieder !), toute la partie instrumentale est bien… Sans plus. Mais après une sacrée période creuse d’une vingtaine d’années, ça fait plaisir de voir Poltergeist revenir avec plus qu’une série de concerts sous le coude. Pas un mais bien DEUX albums après vingt ans…cela mérite qu’on y tende une oreille !
PLIGHT RADIO - "When Everything Burns Within"
Onirique, cosmique, d’un autre monde… Peu importe le qualificatif, cet album de Plight Radio fait voyager. Et pas du tout dans le registre trippant, mais bien relaxant et doux. Tout en ne manquant pourtant pas d’énergie, surtout sur les fins de morceaux… Toujours en apothéose ! Chaque titre est également très coloré, malgré une totale absence de vocals sur chacune des cinq chansons qui composent ce premier opus. En effet, ne vous laissez pas méprendre par ce cinq-titres : d’une durée de six à huit minutes, les chansons au nom doucement poétique (« Rising Wind », « Astronomical Horizon » ) ont pleinement le temps de déployer leurs meilleurs et nombreux atouts. Que ce soit la boucle hypnotisante nous suivant tout du long sur « Rising Wind » ou la progression magistrale sur « Eleonora » : on a un rythme tribal qui échange sa place par une cavalcade de percus puissantes contrastées par une guitare très tendre, pour finir avec force et fracas ! Tandis que « Olimpia » est un semi-retour au calme… en demi-teinte seulement, puisqu’encore une fois la seconde moitié du titre ne manque pas de peps et de nuances pour nous transporter dans des dimensions astrales ! Clairement une excellente surprise, sur laquelle vous pouvez vous jeter immédiatement… L’album vient de sortir !
DEVIL’S BARGAIN - "Visions"
Deuxième opus pour les heavy metalleux (ha ha) de chez Devil’s Bargain, et autant faire amende honorable directement : le genre est vieux de cinquante ans. Il est donc tout à fait normal qu’il soit difficile de se renouveler, et que certains éléments reviennent de manière cyclique. Surtout en considérant que la majeure partie des groupes récents prennent pour exemples Accept, Judas ou Maiden (et on ne les blâmera pas !) Néanmoins, difficile de ne pas trouver un certain manque de relief, de folie, de spécificités dans la musique de Devil’s Bargain. Pire que ça, on a parfois l’impression qu’ils piochent allègrement dans tous les râteliers sans spécialement trouver leur propre style. Bien sûr, on a des vocals déployés par un chant clair, quasi-grandiloquent. Certes, on a des riffs aussi techniques que stridents. Oui, on a une courte intro assez chouette sur « Sign of the Times ». Mais ça ne suffit pas à en faire un album mémorable, même en tant qu’hommage. Car le heavy, en tant que premier genre vraiment porteur, représente tout de même un gros fourre-tout duquel tout le reste a découlé. Et en tant que tel, est-il vraiment possible de comparer Sabbath, Priest et Maiden ? Le doute est permis, et surtout : c’est ce qui semble freiner Devil’s Bargain sur sa lancée. S’inspirer du passé pour le sublimer n’est en rien un mal. Mais ici, ils ne semblent rien en faire, ou bien, peine à en dégager un style véritablement personnel. On admettra au moins que leurs sources d’inspiration sont qualitatives, et que le talent lui est bien là. Espérons cependant que de cette matière brute sortira bientôt un nouveau diamant.
[EVERTRAPPED] - "The Last Extinction"
Juste après avoir sorti un remaster de leur album « Anomaly » (bien sobrement nommé « Re-anomaly »), le quintet de Montréal en remet une couche avec près d’une heure de contenu tout frais ! Manipulant à la perfection ce délicat mix entre des compos ambitieuses, nous caressant les oreilles (ça, c’est pour le côté Melodic) et l’aspect abrasif plus terre-à-terre du Death, chacun des morceaux déploie ses meilleurs atours tout du long. Et avec 5 minutes 30 pour le plus court (et presque huit minutes pour le plus long qui clôt l’album : « Learning To Kill »), autant dire qu’ils n’ont pas hésité à s’en donner à cœur joie. Soulignons l’intro majestueuse de « Stillborn Era », le nihiliste « The First Machine » ou encore « Illusion » et son bridge d’une maestria fabuleuse, prouvant que plus c’est long plus c’est bon (tandis que l’atmosphère, tragique et puissante, qui s’en dégage en fait l’un des meilleurs titres de ce nouvel opus). De plus, à la vue de ces noms (et à l’écoute de leur musique aussi, pas d’inquiétude) on comprend que « The Last Extinction » met clairement l’apocalypse (voire le post-apo) au centre de son univers. Cela passe tant par les paroles que l’ambiance dégagée ou même la pochette. Nouvelle réussite pour un groupe très constant, TLE fera un magnifique plat de résistance après l’apéritif Re-Anomaly… Prendre un dessert ? Tâchons de nous montrer raisonnables…
SOULS OF TIDE - "Black Magic"
Il faut croire qu’il y a un véritable lien entre la Scandinavie et les genres du passé… Si The Night Flight Orchestra épate à chaque nouvelle sortie, Souls of Tide nous prouve qu’ils sont loin d’être les seuls à tirer leur épingle du jeu en termes de hard rock, loin de là. Et plus que de la nostalgie un peu amère, on a davantage l’impression d’être carrément catapulté aux heures de gloire de ces genres, encore aujourd’hui largement représentés… mais parfois avec plus de bons sentiments que de réels talents. Ce n’est pas du tout le cas du sextuor norvégien, dont les bridges forment la plus grande force. Rien d’étonnant à ce que les titres les plus longs que sont « Evening Star » et « The Offering » en soit les meilleurs exemples ! Forcément, plus c’est long, plus c’est bon. Mais que cela ne vous donne pas d’excuse pour zapper d’autres très bons titres tels que le morceau éponyme, qui groove sévère avec une belle énergie. Tandis que « Voodoo Ritual », c’est un peu tout ça… Et bien plus ! Un refrain très efficace, une basse qui nous caresse, de la guitare qui alterne entre riffs puissants et lignes groovy, et bien sûr une batterie des plus efficaces pour donner du corps et de l’impact à tout ça. C’est bien sûr subjectif, mais on le perçoit aisément comme la pépite de l’album. Quoiqu’il en soit, et malgré des thématiques ésotériques qui ferait certainement très plaisir à Blue Öyster Cult, Souls of Tide va au-delà de la pléthore de revival que l’on voit depuis une bonne dizaine d’années maintenant. Et c’est ça qui est bon !
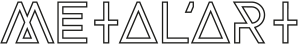






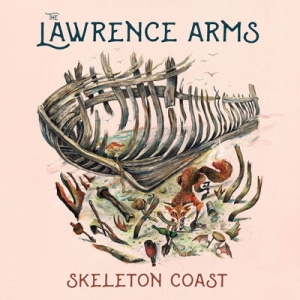











![[EVERTRAPPED] - "The Last Extinction"](/media/k2/items/cache/ce11944b98d0742eead2b016a253afd2_Generic.jpg)
