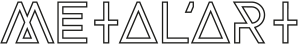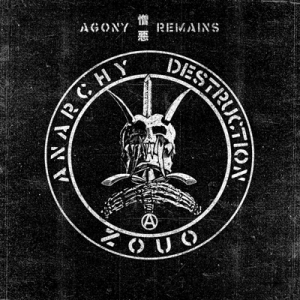Ale
METHADONE SKIES - "Retrofuture Caveman"
Serez-vous étonné d’apprendre qu’il s’agit d’un opus post-rock, à la vue d’un tel nom de groupe et d’album ? Sans doute pas trop, pas plus qu’en voyant la durée des cinq titres proposés sur la galette. On pinaille, on taquine, mais ce quatuor distille les influences non seulement post-rock, mais aussi doom et stoner depuis une grosse décennie maintenant, et leur relative discrétion rend d’autant plus savoureuse la découverte de leur travail. Chaque opus est un peu différent et mise davantage sur l’un des trois ingrédients du cocktail (même si les deux autres ne sont jamais bien loin !) et on peut s’attendre systématiquement à du nouveau son (presque) tous les deux ans, avec un petit bonus sous forme de remaster de leur premier bébé en octobre de l’année dernière. Dernier élément très accessoire, mais notable, ces braves gens viennent de Roumanie et tout porte à croire qu’ils sont non seulement les premiers artistes de ce pays que je chronique, mais aussi les premiers dont j’écoute la musique, tout court. De quoi donner l’envie de se pencher davantage sur une énième scène bien trop peu reconnue et qui recèle, peut-être, de pépites telles que Methadone Skies.
De cette intro élogieuse, vous retirez certainement un portait plutôt positif, et finalement assez commun à mes chroniques du genre (que voulez-vous, j’aime les titres oniriques…). Il serait bien difficile de le nier : j’ai été charmé par ces cinq morceaux exemplaires, très contemplatifs et jouant davantage avec l’ingrédient « post-rock » pour le coup (désolé pour les plus metalleux : les titres sont ici lumineux et aériens !). La plage tutélaire, débutant l’album, est une fameuse aventure de près de dix-huit minutes de long ! Alors qu’aux alentours des neuf minutes, on attend une longue et lente outro cosmique qui n’en finit plus, les derniers instants du morceau s’alourdissent et prennent une allure pesante et oppressante… De quoi injecter un peu de doom dans cet album ! « Infected by Friendship » retourne vers une mélodie nettement plus douce et captivante, prenant une tournure épique dans sa deuxième moitié. « The Enabler » suit avec une rythmique nettement plus marquée et monotone, où batterie et guitare tronçonnent cette fois pendant pratiquement toute la durée du morceau. On doit dire que les quelques secondes de percussions tribales du début auraient gagnées à rester plus longtemps pour rajouter un peu de couleur au titre. Le prochain titre prend le total contrepied en alternant les ambiances et les rythmes de nombreuses fois : on débute en retournant vers la douceur et le contemplatif pour « Western Luv’ 97 », mais pas pour bien longtemps, puisque la machine s’emballe et donne des allures de doom-stoner plus marquées, les deux salles ne se mélangeant jamais vraiment pour au contraire toujours se tirer la bourre, comme pour jongler entre ce côté rêveur et au contraire nettement plus mélancolique et lourd. Enfin, « When The Sleeper Awakens » propose une guitare plus cradingue, presque punk ! La batterie aussi est plus franche, allant bien avec le tranchant de la guitare. Le tout s’achevant de façon lente et lourde, comme pour boucler ce chapitre sans toutefois concéder la moindre force à ce récit dantesque. Bref, ce nouveau bébé est un vrai petit bijou qui place Methadone Skies au centre de la carte du post-rock (comme quoi il n’y a pas que les Italiens !) et il nous tarde de replonger dans leurs quatre premiers opus… et d’attendre fébrilement le prochain, que l’on présume voir sortir d’ici une paire d’années !
ZOUO - "Agony Remains"
« Un joyeux bordel ! », voilà comment on pourrait qualifier cet album-hommage à Zouo. Et c’est plus un compliment qu’une tare dans ce cas précis. En effet, après ma précédente critique du nouvel album de S.H.I., dernier bébé de Cherry Nishida, il paraissait de rigueur de revenir aux sources en tendant une oreille attentive à cet opus « bonus » sortant en même temps chez Relapse. Et on vous avertit tout de suite : oui c’est plus crasseux, oui c’est plus brut, oui c’est plus bricolé. Cet album, taillé comme un patchwork, n’a pas la maturité, la maitrise ou même la simple qualité technique de son tout jeune confrère. Mais il serait également injuste de les comparer outre mesure : Zouo est non seulement un projet plein d’enthousiasme juvénile et d’expérimentation fébrile, mais aussi un groupe datant de plus de trente-cinq ans ! Prenons donc davantage cette créature chimérique pour ce qu’elle est, c’est-à-dire une relique, une capsule temporelle vers une époque et un lieu auquel nous, Européens, n’étions pas forcément familiers.
Autre mise en garde d’importance : « seuls » les six premiers morceaux de la galette sont d’un enregistrement convenable et même « classique », et proposeront alors un confort d’écoute plus que correct. Le chant paraitra totalement différent à ceux qui connaissent le travail de Nishida sur S.H.I. : on se trouve ici vers quelque chose à la croisée des chemins entre les Ramones et les balbutiements du Black (pas réellement une coïncidence : c’était l’époque, d’autant plus au Japon !). On s’amusera d’ailleurs de la prononciation des refrains, ressemblant parfois à de drôles d’onomatopées, mais beuglés avec une telle énergie qu’on se prend directement au jeu ! On appréciera aussi la pluralité des idées vis-à-vis des sonorités, même si par moment on aurait apprécié certainement davantage l’un ou l’autre titre avec un rien d’effets en moins, justement pour que les instruments paraissent moins « étouffés » et que les morceaux respirent davantage. Mais ce côté plus foutraque et pétaradant a aussi du bon, et cette fusion ressemblant justement à du « black thrash » des débuts fait vraiment plaisir. Après, le côté thrash ressemble plus à du punk rock tout de même (surtout sur « Frustration » ou « Bloody Master »), tandis que la dimension black s’arrête au chant caverneux et aux thèmes des morceaux (« Fuck the God » ou « Making Love With Devil »). Mais cela fait malgré tout une intéressante amalgamation, qui ne plaira pas à tous, très clairement, mais qui a le mérite d’être faite avec les meilleures intentions et avec un fun des plus plaisants.
Le reste de l’album amplifie les côtés « patchwork » et « joyeux bordel » que j’évoquais plus haut. Il s’agit en effet de neuf titres, divisés en trois lives différents. Cela donne donc des atmosphères différentes, des qualités de prises de son différentes, et bien sûr des titres différents également. Certains font partie des six chansons en tête d’album, d’autres sont uniques et représentent peut-être la seule occasion de réentendre ces morceaux balayés par les sables du temps. Tant pis si la qualité est plus que sommaire : tel un spéléologue retrouvant un bout d’os non identifié, on aurait du mal à trouver quoi en faire pris séparément. Mais en y associant le bon contexte et les bons éléments annexes, cela prend tout son sens.
Comment clôturer cette critique ? Sans doute en énonçant clairement à qui cet album est destiné : aux curieux. À ceux qui ont découvert Cherry Nishida avec S.H.I. et en veulent encore plus. Aux profanateurs de sépultures, prêts à déterrer des pépites d’un monde qui nous est presque entièrement inconnu. Sans doute que pour le commun des mortels, cet album très brut à la qualité sonore bancale ne sera pas une expérience inoubliable. Mais nul doute que pour le passionné, il représentera un vrai trésor.
S.H.I. - "4 死 Death"
Comme bien des passions, on dira de la musique qu’elle doit (généralement du moins !) rester un plaisir. Cela se manifeste de plusieurs façons : la sensation de nostalgie en retombant sur un album oublié, la joie teintée de gourmandise de découvrir un artiste à la carrière bien remplie, l’extase de retrouver un artiste aimé qui s’était « perdu » dans des expérimentations pas toujours à notre goût… ou encore la sensation de trouver une mine d’or en mettant à vif une scène qui nous était jusqu’alors inconnue. On peut dire que S.H.I. (pour « Struggling Harsh Immortals », on aime les noms japonais !) s’inscrit totalement là-dedans, à des degrés différents, mais tous décuplant le plaisir d’écoute. Les critères ne paraissent pas cumulatifs ? Détrompez-vous. Certes, la sensation de nostalgie est « factice », puisque je découvre totalement le travail de longue haleine de Cherry Nishida, débuté lors des années 80. Mais assurément, il faut avoir été punk aux grandes heures du punk pour pouvoir faire du punk. Cet album nous le prouve amplement : rarement entendu un opus récent d’aussi grande qualité et paraissant saisir à ce point l’essence de la musique. Ce qui ne signifie pas qu’il ne s’agisse que d’une resaucée peu inspirée, voire larmoyante sur un passé doré en mode « c’était mieux avant ». Au contraire, l’artiste insuffle quelques bonnes idées, héritées de la noise (pour le côté plus tradi) et de l’indus (pour le côté plus novateur). Et que c’est bon ! Un titre comme « Terminus » ou « Hell Bounded Heart » perd sans doute de l’humour et de l’accessibilité du pop punk, mais on y gagne en force d’impact. Si l’on comprend la tournure plus radiophonique prise par le genre à la charnière 90s/2000s, on aurait aimé que davantage de groupes gardent d’autres relents des 90s (grunge, indus, hip-hop… why not ?). Et pour ceux qui veulent des morceaux plus classiques du genre, « Casualty Vampire » et « Theme 2 » sauront assouvir votre soif de gros titres à pogo, avec de la disto à gogo. Au passage, saluons ces titres de morceaux, sonnant comme des attaques de J-RPG… ou des noms de J-RPG tout court ! C’est anecdotique, sans doute même de quoi rendre perplexe les artistes derrière ces titres, mais de mon regard occidental, cette faculté à rendre épique des tournures pourtant un peu kitsch fait sourire. Quid des deux autres « plaisirs » que j’évoquais plus haut ? Ils ne sont pas en reste : S.H.I. n’a encore que peu de matière à son actif depuis sa création il y a une petite dizaine d’années, mais le sieur Nishida n’en est pas à son coup d’essai : le label ressort ainsi son travail avec ZOUO, et c’est sans mentionner « Danse Macabre » ou « Nankai Hawkwind ». Jamais des groupes à la longévité impressionnante, et dont la musique est difficile à trouver chez nous, mais autant de bonnes raisons de jouer les spéléologues. Enfin, quant au fait de retrouver un artiste aimé qui se serait perdu en expérimentation… OK, ce n’est pas vraiment le cas ici. On a plutôt à faire à un artiste discret, polymorphe et méconnu. Mais si vous devez retenir une chose de cette longue chronique qui part dans tous les sens, c’est qu’il faut vite checker autant la carrière de ces keupons japonais, dont la scène est décidément trop injustement boudée alors qu’elle est d’une richesse insolente, que ce nouvel album du dernier-né de Cherry Nishida. C’est puissant, c’est rythmé, ce n’est pas trop verbeux mais avec un chant bien gras et grave, et ça s’acoquine de quelques fantaisies jamais gadgets, qui rajoutent au contraire des éléments propres à S.H.I. tout en ne devenant pas une bouillie incohérente. Du grand art, et bravo aux punks du Japon !
SCRTCH - "Möther Sümmer"
Un jeune duo qui va à l’essentiel, dans tous les sens du terme ! Revenant deux ans et demi après leur premier EP, avec deux petits titres (ah ce n’est pas beaucoup !) au nom de l’album (« Mother » et « Summer » donc). Ils sont surtout déterminés à nous démontrer qu’on peut faire plein de choses avec une basse et une batterie. Pour autant, on doit dire regretter un petit manque de folie et d’expérimentation, pourtant principal fer de lance du genre de la noise (alors du « noise PUNK » en plus vous imaginez). On aurait sans doute voulu que ça gueule un peu plus, que ce soit plus foutraque et vénère. On se surprendra aussi à songer à « My Sharona » des mythiques Knack lors de l’intro de « Sümmer », on penchera sur un hommage inconscient, provoqué davantage par le débit du chant qu’une quelconque volonté malicieuse. Mais si on occulte ces petites piques pas très sympas, qu’est-ce que ça vaut ? Et bien c’est pas mal du tout ! « Sümmer » conserve une belle énergie et cette rythmique pointée du doigt est efficace, elle donne justement quelque chose de plus souple et agréable par rapport au Noise plus classique (et bordélique). L’intro de « Möther » est très sympa aussi, avec cette basse simple et oppressante, traînant pendant une minute avant d’exploser. On y retrouve cette fois-ci quelques riffs un peu « Tostaky-en » mais ici relevant totalement de l’impression personnelle. On saluera surtout sur ce titre le clivage entre le côté plus posé des couplets et les cris lors des « MOTHER ! », « MOTHER ! » nous plongeant dans le désespoir le plus profond où il ne nous reste plus qu’à pleurer notre mère, figure décidément toujours faste pour nourrir l’imaginaire des créatifs. Saluons aussi son outro, tout en distorsion, et venant me clouer le bec alors que je voulais du noise. C’est moins bordélique ? Certains y verront une qualité : qu’il s’agisse d’une porte d’entrée ou simplement d’un exemple plus accessible du genre. On reste un peu sur notre faim, notamment aussi par ce goût de trop peu qui se dégagent de ces même pas dix minutes d’écoute. Mais il y a toujours un côté diablement touchant aux jeunes groupes sortis d’on ne sait où et qui sont déterminés à casser la baraque avec un genre pas forcément des plus porteurs. Avec en plus la pandémie leur tombant dans les dents à peine leur premier EP dans les bacs, cela n’a rien d’évident. Persévérez, les gars ! Hâte de découvrir un album complet de votre part.
BLITZKRIEG - "Theatre of the Damned"
Si certains mettent leur temps à profit lors de la pandémie pour nous sortir de nouveaux sons, d’autres ressortent les fonds de tiroir. Après le très sympathique EP « Loud and Proud » il y a une grosse année et demie, voici de retour un album de très bonne facture, gratiné de vinyles pour l’occasion. Mais surtout, et ça nous intéresse plus ici, de deux titres bonus. Le premier « Armageddon », est efficace, mais assez peu remarquable. Mais il s’insère parfaitement dans le reste de l’album, et puis surtout… Sommes-nous bien aptes à juger une quelconque convenance musicale lorsque le groupe en question était déjà là lorsque tout a été inventé et codifié ? Parler de bridges très classiques ou de paroles kitsch n’aurait que peu de pertinence ici (même si, déjà en 2007, ce heavy à l’ancienne sentait déjà un peu le réchauffé). Et puis, cela n’empêche pas certains titres tels que la plage tutélaire, « Tortured Souls » ou « Spirit of the Legend » d’avoir ce « petit goût de reviens-y » porté par des guitares qui s’emballent ou des refrains certes un brin niais, mais dont le plaisir coupable est inégalé, sauf peut-être au sein du power (qui doit beaucoup au heavy de toute façon). Et ce phénomène trouve sa synthèse, à défaut de son apogée, dans le deuxième et dernier titre bonus, sobrement baptisé « Blitzkrieg ». Tout un symbole. À défaut d’un apogée puisqu’il faut avouer que là aussi : ça manque un peu d’ambition, de créativité. Cela déçoit quelque peu, on se dit qu’un tel titre aurait mérité d’être un bouquet final cataclysmique. De fait, on croise les doigts pour que les Anglais aient encore quelques cartouches dans le ventre. Aussi appréciable soit cette ressortie, elle manque un peu de panache s’il s’agit là du couronnement de 41 années de carrière. Fort heureusement, rien ne semble indiquer qu’il ne s’agisse plus qu’une supposition !
BEWITCHER - "Cursed Be Thy Kingdom"
Quelle praline ! Avec un nom pareil, on aurait pu s’attendre à du power classique (et le groupe lui-même s’inclut dans une mouvance black), mais il n’en est rien : on a droit à du speed, et d’excellente facture ! Et c’est une bouffée d’air frais, étant donné qu’une bonne partie des sorties récentes du genre ressemblent plus à du Thrash mal assumé qu’à du bon speed typé 90s. Bewitcher vient changer ça, tout en respectant les codes heavy des pionniers. On retiendra surtout les bridges de ces dix titres : ils sont tous très bons et énergiques, pour certain même plutôt mémorables (celui de « Electric Phantoms » par exemple, ou le très groovy « Valley of the Ravens »). On saluera aussi une certaine mythologie déployée par le groupe, souvent un peu nanardesque, mais portée par des refrains impeccables (« Metal Burner » ! Ou « Mystifier ») Quand ce n’est pas tout simplement de la maestria en barre avec un titre bondissant et frénétique comme « The Widow’s Blade » ! En vérité, le seul reproche que l’on pourrait formuler ce serait une tromperie pour les fans de black, qui n’ont sans doute plus grand-chose à attendre de Bewitcher (malgré quelques touches timides, mais toujours bienvenues). Les autres découvriront des bridges somptueux et du speed comme on n’en fait que trop peu. Une gourmandise, vous dis-je !
A RIVER CROSSING - "Forsaken"
Nom spirituel, en lien avec la nature. Check. Titre d’album cryptique, basé sur un mot assez polysémique. Check. Morceaux plutôt longs et misant gros sur leur atmosphère. Check aussi ! Ouaip pas de doutes possibles, on est sur du post-rock de chez Antigony. Nous venant cette fois de Suisse, le quatuor semble habitué aux idées parfois abstraites et étonnantes (leur précédent album s’appelait « Sediment » et une de ses pistes s’appelait « [ ] » pour… « Square » !) Bref, comme souvent avec le post-rock, ça expérimente, ça part dans les concepts et ça va souvent là où on ne l’attend pas forcément pour nous proposer une véritable balade aussi sonore que mentale. Et ce n’est pas le bien engageant diamant/mandala de l’artwork qui viendra nous contredire. Première surprise à l’écoute du premier morceau « Ashes » : ça parle ! Rien de très verbeux bien sûr, et que sur une partie des albums, mais ça reste un parti pris plus rare que coutumier dans le genre. L’idée n’a rien d’idiote, elle est bien exploitée et elle reste bien dosée : les instruments gardent une part des plus importantes et nous bercent magnifiquement. Il est vrai qu’à titre personnel, ce sont ces derniers qui priment au sein des compos post-rock et l’absence de chant permet généralement de pleinement se laisser divaguer. Du tout-instrumental n’aurait donc pas déplu, mais ça ne gâche pas le plaisir. Ce qui déplaît peut-être un peu plus c’est peut-être justement des bridges parfois étirés un peu en longueur et manquant un brin d’imagination. C’est efficace, surtout au casque, mais ça manque de ce petit quelque chose d’unique qui rendrait vraiment l’album pleinement mémorable. Qu’importe finalement. L’avantage du genre sur bon nombre de ces petits camarades, c’est précisément qu’il fera toujours voyager et rêver. Parfois en terres inconnues ou en terrains connus. Mais toujours avec cette brise porteuse de liberté qui rend amère la minute où l’album se clôt.
Aborym
Machine de guerre de Fabban qui mène le navire depuis presque trente ans maintenant, Aborym a eu l’occasion de changer son fusil d’épaule maintes fois, jonglant entre les genres et les influences, pour proposer des albums jamais réellement analogues. Un peu plus black au début, et épousant aujourd’hui l’indus de manière plus franche, les Italiens sortent des carcans pour faire ce qu’ils veulent, et c’est peut-être pas plus mal ! Rejoint aujourd’hui par trois comparses puisque débordant de la furieuse envie de reprendre les concerts, le très prolifique Fabban a accepté de nous parler de cette dernière sortie, initialement prévue pour 2020, en compagnie du petit nouveau Tomas Aurizzi.
Bravo pour ce nouvel album les gars ! De ce que j’ai pu lire, “Hostile” est supposé être votre album le plus éprouvant jamais sorti, et même votre magnum opus ! Est-ce que vous pourriez spécifier ce que cela veut dire? Qu’est-ce qui change sur ce nouvel album? Qu’est-ce qui lui donne les mérites d’être qualifié de “Magnum Opus” après près de vingt ans de carrière et de sorties?
Tomas Aurizzi : Merci, cela fait plaisir à entendre. Je pense que ce qui rend “Hostile” différent de nos travaux précédents est qu’il a été composé avec la contribution active de chacun des membres du groupe. Même si j’ai personnellement rejoint le groupe alors que l’album était en préparation, j’ai eu la chance de glisser quelques idées aussi. Et surtout, Fab a partagé sa longue expérience avec nous, et pas seulement en termes musicaux, mais aussi en termes de production. Sa plus grande prouesse était de parvenir à faire évoluer le groupe en nous laissant échanger des idées pendant l’écriture de chaque chanson. Personnellement, je pense que c’est l’album le plus complet auquel j’ai eu la chance de participer, et j’en suis très fier. Doit-il être considéré comme notre Magnum Opus? Notre but est de toujours placer la barre plus haut, de notre propre façon, par le biais de l’expérimentation et de la combinaison d’idées, et surtout de toujours chercher à améliorer la qualité de notre musique.
De façon similaire, j’ai également lu que vous parliez de votre son comme d’un “étrange mix kaléidoscopique” et même que votre objectif était de faire de la musique “qui n’avait jamais été entendu auparavant”. Comment atteindre de tels objectifs d’une façon qui reste cohérente et agréable à l’oreille? Comment produire un album entier, avec quatorze chansons, sur ce principe?
Tomas Aurizzi : C’est ce qui est génial avec l’expérimentation et la musique, que l’on retrouve dans d’autres activités créatives ou culturelles, et qui forme donc la base de notre travail. Si ce ressenti paraît “kaléidoscopique”, cela nous convient, et on ne l’entend pas souvent décrit de la sorte ! On cherche uniquement à exprimer nos émotions et notre bagage artistique. On trouve cela bien de prendre des risques en abordant l’art, de créer quelque chose d’inattendu et de sortir de notre zone de confort. D’oublier, d’abandonner les vieux patterns dont nous avons pris l’habitude.
Je l’ai peut-être halluciné, mais ce sont bien des influences grunge que j’ai entendues sur certaines chansons? Bien sûr, le metal industriel et le grunge sont des genres contemporains. Mais malgré tout, est-ce que cela fait partie de ce fameux “kaléidoscope”?
Tomas Aurizzi : Oui, j’adore le feeling du rock et du grunge des années 90. Tu n’as pas halluciné, et nous allons certainement conserver ce feeling dans nos futurs projets d’une façon ou d’une autre ! Mais il ne faut pas s’attendre à ce qu’on devienne un groupe de grunge non plus. À vrai dire... Je ne sais pas moi-même à quoi m’attendre, et c’est ça qui est beau ! J’aimerais d’ailleurs rajouter quelques mots vis-à-vis de ce son kaléidoscopique : nous ne sommes pas entrés en studio avec l’idée de produire une sonorité particulière. On a simplement joué ensemble, rassemblé nos idées et partagé nos expériences... avant de mélanger le tout !
J’ai cru comprendre que cet album a aussi connu un changement de line-up assez important. Vous étiez quatre en studio, avec l’arrivée de Tomas et aussi, si je ne me trompe pas, la première fois où Gianluca joue un tel rôle dans l’enregistrement d’un album. Comment était-ce d’enregistrer avec quatre têtes et huit mains cette fois? Qu’est-ce que cela a apporté? Était-ce plus facile ou difficile?
Tomas Aurizzi : Ah ! Il faut alors revenir à la première question vis-à-vis de cela, lorsque nous abordions la capacité de Fabban à nous coordonner au sein du groupe. Ce n’était pas difficile pour nous d’être dans cette situation, c’était assez naturel et si ce n’est nos expériences respectives qui différaient, on était tous invité à apporter sa pierre à l’édifice par notre technique. On a chacun un studio à domicile, ce qui permettait d’accélérer et surtout de préserver tout le processus créatif. Partager un album avec ces trois autres gars représente vraiment ma meilleure expérience musicale jusqu’à présent ! Leur professionnalisme est impeccable et nous avons travaillé main dans la main avec notre ingénieur du son Andrea Corvo (que l’on perçoit comme un “cinquième membre” du groupe). Il a collaboré avec nous depuis le début du processus d’écriture, jusqu’à l’enregistrement bien sûr. Sans parler de l’aide précieuse de Keith Hillebrandt, notre producteur.
Quel élément a poussé ce changement de line-up, si longtemps après la création du groupe? Comment votre collaboration a pris forme?
Tomas Aurizzi : De ce que j’en sais, Fab voulait ramener Aborym en live, ce qui nécessitait d’avoir un line-up plus stable. Quand j’ai rejoint le groupe, il avait déjà entamé ce processus de “reconstruction” en incorporant Kata, notre batteur, et un bassiste. Maintenant, nous avons trouvé cette alchimie entre nous tous, et même si nous venons de sortir un album, nous sommes impatients de nous remettre au travail avec les autres.
Quelques mots peut-être à propos de la vidéo qui accompagne le single “Horizon Ignited”? Elle a une iconographie très abondante ! J’ai remarqué les références évidentes à la religion, et ce que je suppose être des scènes de la Chine pendant la pandémie. Quelques références à la drogue et aux médias, avec des gens qui “dévorent” littéralement ce qu’ils voient... On dirait qu’il y a beaucoup à digérer ! Quel est le message global du titre? En prenant en compte autant les paroles que le clip, je dirai que le titre nous invite à reconsidérer ceux que l’on doit blâmer pour ce que nous sommes en train de vivre. Mais je me trompe peut-être?
Fabban : J’ai essayé d’aborder ces sujets délicats avec une approche surréaliste, presque “lynchienne”. Je ne cache pas que mon but était d’instaurer une ambiance dérangeante, marginalisante... De la même façon que le font les films de David Lynch. Cette chanson parle de l’absence de Dieu lorsque les gens font appel à lui. Et d’une certaine façon, l’apparition de la pandémie pendant que je préparais le clip qui accompagne le morceau était presque prophétique. Je pense que toute la mythologie entourant la religion est absurde. Je pense, je crains même que cela ne soit qu’une histoire, presque un conte de fées, que l’humanité a imaginé pour se rassurer face à la peur de la mort. Le message est aussi simple que cela, et la pandémie représentait le terreau parfait pour marteler le message à grands coups d’images et de visuels. Les gens demandent de l’aide à Dieu lorsqu’ils souffrent, lorsqu’ils ont peur et les personnes les plus fragiles réagissent avec colère et désespoir lorsque leurs prières ne sont pas entendues. Certaines se tournent alors vers l’athéisme...
Vous semblez avoir une tendance à trouver des noms insolites, à la fois pour vos chansons, mais aussi vos albums ! Il y a bien sûr votre premier jet “Kali Yuga Bizarre” ou encore “Psychogrotesque”. Sur ce dernier album, on trouve les titres “Lava Bed Sahara” ou “Magical Smoke Screen”... Comment trouvez-vous ces noms étranges? Est-ce que vous voulez guider la représentation de vos auditeurs?
Fabban : En fait, tout est accidentel... Surtout lorsqu’il s’agit de trouver les titres des chansons. “Lava Bed Sahara” a été écrite lorsque j’étais en Afrique il y a quelques années. J’ai eu l’opportunité d’arpenter une partie du désert avec ma femme et quelques guides locaux, et j’ai alors gribouillé quelques phrases sur un bout de papier. J’étais fasciné par l’étendue du Sahara et en même temps effrayé à l’idée de devoir le traverser. C’est une chanson qui peut être interprétée sous le thème de l’immigration, un domaine qui m’est cher. Chaque jour, des milliers de gens entament un trajet périlleux afin de trouver un refuge, une protection dans un pays qui voudra bien les accueillir. Que ce soit causer par la faim, la persécution, la violence... Ils laissent tout derrière eux pour arpenter des routes illégales et dangereuses à la recherche de sécurité. Certains n’arrivent jamais à leur destination. Pour “Magical Smoke Screen”, on retourne vers Lynch, et cette fois les paroles furent écrites en utilisant la technique du “cut-up” si cher à William Burroughs. Cette technique littéraire permet aux écrivains d’emprunter la technique du collage, utilisée par les peintres notamment. D’une certaine façon, pour ce titre, on l’a réactualisé tout en s’assurant que cela reste cohérent pendant le processus d’écriture.
Malgré une petite pause en 2020, vous avez été très productifs ces dix dernières années ! Sept albums si je ne m’abuse, avec notamment “Something For Nobody” qui est divisé en trois. Comment maintenir un tel rythme? Qu’est-ce qui vous a poussé à produire autant de contenu? Avez-vous eu un éclair de génie?
Fabban : Je suis hyperactif ! J’ai la chance de pouvoir dire que les dernières années ont été productives. J’ai été co-producteur avec Keith Hillebrandt sur la cover du titre “Maneater” de Nelly Furtado par le groupe “Digitalis Purpurea”. Puis j’ai effectivement fait les trois “Something for Nobody”, qui est une sorte de trilogie présente en édition limitée sur vinyle. J’ai composé la musique du film “Quid” et bien sûr plusieurs albums entre tout ça... Il faut dire que je vis à cinq minutes du studio où nous composons et commençons les préproductions avec Aborym. Dès que j’ai une idée, je vais directement la fixer en studio pour ne pas la perdre. Ainsi, chaque chose peut se mettre très rapidement en place.
Question un peu bête, mais pourquoi avoir sorti l’album “Shifting.Negative” entre deux albums de la trilogie “Something for Nobody”? Était-ce un projet que vous ne pouviez plus garder en suspens?
Fabban : Le cas de “Something for Nobody” est un peu particulier, car il ne s’agit pas de réelles “nouveautés” d’Aborym, mais plutôt une collection de titres jamais sortis, de remixes, de versions lives, des titres inachevés et même des prises alternatives ou mastérisées différemment. C’était une expérience très intéressante et un bon catalyseur pour l’évolution du groupe. Cela nous a permis personnellement de mieux nous connaître, mais aussi une façon de sortir du nouveau contenu qui nous paraissait intéressant.
Au sein de plusieurs chroniques écrites récemment, j’ai eu l’occasion de redécouvrir et d’apprécier la scène musicale italienne, qui semble très diversifiée. Votre pays paraît avoir beaucoup d’artistes de talents, évoluant dans des genres parfois très différents. Comment expliquer cela? Est-ce qu’il y a un élément typiquement italien qui sert de terreau à cette scène cosmopolite?
Tomas Aurizzi : Je suis heureux de voir la scène musicale italienne évoluer. On voit qu’elle commence doucement à dépasser les frontières nationales, et même à être reconnue comme spécifique à notre pays. J’aimerai bien que cette tendance se poursuive, et pas seulement dans l’industrie de la musique.
Néanmoins, on dirait que la musique industrielle, tous genres confondus, reste une affaire très “nord-américaine”. Il y a certes une scène allemande qui reste très marquée, mais dans le reste du monde, elle paraît plus sporadique. Plus discrète peut-être. Comment expliquez-vous cela? Quelle est la situation de l’indus en Italie par exemple?
Fabban : Je pense que l’Italie n’est pas encore “prête” pour ce genre de musique, mais je lis beaucoup de réactions très positives autant des fans que de la presse spécialisée à propos du nouvel album. Le marché de la musique est contrôlé par l’industrie, mais aussi par les magazines, les radios ou la télévision. Cela ne rend pas toujours facile de percer lorsque la grande majorité des gens est dirigée, consciemment ou non, vers du contenu préfabriqué, survendu par les médias. Les autres ayant la chance de sortir un album peuvent s’attendre à ce qu’il soit chroniqué, jugé et oublié en un week-end... Et encore, avec de la chance !
Comment la pandémie a affecté la conception de ce nouvel album? Tous les artistes reçoivent sans cesse cette question bien sûr... Mais quel est votre point de vue? Est-ce que c’était plus facile ou difficile d’enregistrer dans ces conditions?
Fabban : Heureusement, rien n’a vraiment changé pour moi, puisque je n’ai jamais arrêté de travailler ! Lorsque je n’oeuvre pas pour Aborym, j’officie en tant que graphiste, et lorsque je me suis occupé des dernières sessions d’enregistrement, le virus ne frappait plus aussi sévèrement qu’en mars 2020. L’album était déjà presque prêt lorsque le virus a frappé de plein fouet. Ensuite, tout le mixage s’est fait à distance avec l’aide d’Andrea Corvo, et j’ai enregistré les paroles des trois dernières chansons en mai, afin de respecter l’agenda. Il y a eu un léger retard dans la sortie à cause des usines tournant au ralenti... Mais il est enfin sorti !
Pour revenir à Andrea, son soutien, ainsi que tous les films que j’ai regardés et les vieux disques que j’ai réécoutés m’ont permis de rester sain d’esprit ! Idem pour le fait de continuer à écrire : ça m’a permis de déstresser et d’arrêter de m’en faire pour des choses que je ne peux contrôler. Ma femme a également été d’une grande aide, c’était salvateur d’être ensemble pendant cette période. Cela commence à faire long, le monde entier est en pause. Ne pas voir ma famille, mes amis et ne pas pouvoir jouer avec le reste du groupe étaient vraiment les choses les plus difficiles. Mais je reste positif qu’on retrouvera tous notre vie d’avant une fois cette pandémie terminée.
Pandémie ou non, “Hostile” est votre plus long album à ce jour ! De fait, cela ne semble pas être dû au confinement... Mais peut-être avez-vous connu une période de créativité et d’inspiration extrême peu de temps avant? Vous êtes vous “confinés” avant l’heure si j’ose dire?
Tomas Aurizzi : Oh, le confinement a tout de même eu une incidence ! Sans aucun doute, le lockdown nous a tous effrayés au début, que ce soit dans le domaine privé ou professionnel. Mais on s’est dit que chaque problème a sa solution, et une fois qu’on la trouve, il n’y a “plus qu’à” l’appliquer. La pandémie a mis en pause la frénésie de nos vies, quelque chose que l’on expérimente tous dans les grandes villes... mais elle nous a aussi permis de nous recentrer sur nous-mêmes, de trouver ce qu’il était vraiment important d’exprimer, et ce malgré toutes les difficultés occasionnées. Indirectement, cela s’est répercuté sur l’album et sur notre objectif principal avec ce dernier : de lâcher prise et d’exprimer nos émotions librement, de raconter cette période inédite qui nous met tous au défi.
Et vis-à-vis de la promotion? Vous avez longuement abordé l’envie de revenir aux tournées, mais cela ne semble pas être pour tout de suite... Comment dire aux gens “l’album est sorti, allez l’écouter!” en temps de pandémie?
Tomas Aurizzi : Le processus de promotion va s’étendre à toutes les plateformes digitales. Nous ne savons pas combien de temps ça prendra pour revenir au live, tandis que les ventes physiques ne pèsent plus très lourd aujourd’hui. Il devient donc crucial d’être présent sur les bons canaux digitaux, malheureusement peut-être. Personnellement, je crois toujours qu’acheter les albums que j’aime, aller en concert dès que ce sera à nouveau autorisé, ressentir et vivre pleinement toute cette palette d’émotions, acheter le merch à la fin d’un show et peut-être même parler aux artistes et partager toutes ces expériences avec une foule... ce sera toujours plus gratifiant, plus excitant que de cliquer sur un lien pour écouter ou acheter sa musique.
Enfin, il me semble que cela fait un moment qu’on ne vous a pas vu en Belgique. Est-ce que vous seriez enclins à revenir nous voir? Comment sont vos souvenirs du public belge?
Fabban : Je n’ai que de bons souvenirs lorsque je repense à mes récentes escapades en Belgique, et j’espère vraiment pouvoir y revenir bientôt. Pour nos fans belges, si je ne peux vous demander qu’une chose, c’est de vous procurer notre nouvel album si vous l’avez apprécié. C’est la seule façon de soutenir les artistes en temps de Covid. Merci pour l’interview, et au plaisir de se recroiser !

OJM - "Live At Rocket Club"
Si vous êtes peut-être, comme moi, amateur de questions que personne ne se pose (comme par exemple « que veut dire OJM ? » ou encore « est-ce que les albums live rencontrent un nouveau public maintenant que les concerts sont proscrits ? » ), vous êtes au bon endroit pour rester sur votre faim. Mais je peux néanmoins partager une anecdote intéressante sur le fait que « Vincebus Eruptum » est un fanzine italien, lui-même nommé en référence à un titre du groupe de rock psyché « Blue Cheer ». C’est d’ailleurs pour célébrer les dix ans de ce magazine (et promouvoir leur dernier album, « vrai » album, en date, « Volcano ») qu’a eu lieu leur concert au Rocket Club. Ce qui remonte… également à dix ans. Donc cette sortie CD commémore les vingt ans du fanzine, vous suivez ? Bref, trêve de background, il est tant de parler musique. Et on commencera par saluer les deux titres « longs » du concert, à savoir « Ocean Hearts » et « Desert » qui donne toute leur signification Stoner (et même un brin psyché) du groupe. Un chant caverneux, une guitare qui groove sévère… Ils forment de plus de beaux entractes aux autres titres, nettement plus typé garage rock justement ! Nettement plus courts, mais aussi plus effrénés et puissants, c’est le noyau dur du concert… Même s’ils paraissent moins tranchants, plus homogènes et de fait, moins marquants aussi. Ils font le taf dirons-nous, et sont bien pêchus comme il faut ! Mais il n'y a pas photo, c’est « Desert » le clou du spectacle. Il paraît plus diversifié à lui tout seul que le reste du CD ! On passe facilement par quatre ambiances, très vastes, jonglant avec les sonorités et les rythmiques pour nous fournir à ce qui s’apparente à une démonstration de force. On aurait presque aimé que tout l’album soit du même acabit, tout en gardant l’intime conviction que les morceaux garage ne sont certainement pas à jeter, ni même à considérer comme simples fillers. Ils sont bien fichus et ont leur place dans l’attirail d’OJM, ils sont simplement « moins bons » et mémorables. Ce qui n’empêche pas « 2012 » d’être plus calme et de poser une atmosphère bien sentie, ou « Give Me Your Money » d’être un joli petit pétard festif et frénétique. Au final, on dira surtout que ce live au Rocket Club démarre vraiment dans sa deuxième moitié, où il devient alors une vraie petite merveille. Et surtout on retiendra que si cela m’a moins surpris que mes dernières chroniques sur de récentes productions italiennes, cela ne m’ôtera pas l’idée qu’ils sont capables de tout faire ces gens-là…
ÆVANGELIST - "Dream an Evil Dream III"
Sans aller dans les détails plus ou moins légaux et complexes (même si la mention « pays » en atteste quelque peu), on se contentera de dire que le groupe propose ici une nouvelle salve après les deux premières incursions début d’année passée avec son nouveau chanteur Stéphane Gerbaud (qui apparemment, serait resté longtemps dans l’ombre après ses participations à Anorexia Nervosa et Necromancia !). Bref, même si le nom de l’album demeure assez nul (jamais deux sans trois, mais pour le coup…), on se dit qu’il est finalement assez bien choisi : il est d’une immanquable continuité à la saga débutée il y a plus de cinq ans de cela. Les thématiques sont nombreuses dans le genre et on n’est guère étonné de retrouver celle du cauchemar pleinement personnifié pour un troisième tour de carrousel (ou de train fantôme, c’est de circonstance). Le titre est ici en un seul morceau et non divisé en deux comme pour le précédent : sans doute plus logique, il faut bien le dire. Un peu moins long aussi, mais gardant l’essentiel d’une bonne recette. Le titre est très atmosphérique, avec des teintes lugubres et obscures, parfois même réellement inquiétantes et oppressantes. On nous offre que très peu de répits durant ces trois quarts d’heure d’intensité hypnotique, flirtant parfois avec le réel malaise, mais toujours calmé par le travail fait sur l’ambiance, notamment à l’aide de « bruits » rajoutant une couche de « réel », d’autant plus immersive. Malgré ces petits instants d’accalmie, notamment lorsque la voix du sieur Gerbaud se met à jouer des coudes pour écarter la guitare, on admettra tout de même que cette longue virée cauchemardesque est tout de même un peu longue, au point d’être un peu lassante dans son dernier quart (même ce que l’on qualifierait d’outro s’éternise pendant bien trois minutes !) Pour le reste, les fans du bonhomme seront contents de retrouver ce troisième opus, dans la digne lignée du second plus encore que du premier et qui pose la question : est-ce qu’on doit s’attendre à une tradition annuelle désormais ?
SETH BORSELLINI - "Moodness"
Une nouvelle fois, l’Italie démontre toute sa pluralité et sa richesse en matière de metal. Et après Aborym il y a peu, on reprend une cuillérée d’indus avec Seth Borsellini, astucieux pseudonyme en référence au dieu égyptien du chaos (déjà, ça annonce la couleur). Il est également vétéran du groupe « Sfregio », ou « balafre » en français, groupe de Thrash plutôt décalé qui aura sorti trois albums, ainsi que de « November Guns », groupe de reprises des Guns’n’Roses. Pourquoi citer de cette façon le CV du bonhomme ? Et bien pour montrer qu’il n’en est pas à son coup d’essai pardi ! Néanmoins, on est loin de ce à quoi l’homme nous avait habitués jusqu’ici. Exit les shorts et les cheveux longs, maintenant c’est crâne rasé et long manteau à la Matrix. Et de fait, le « mood » (ha ha) de l’album est bien différent du reste de ses œuvres. On reconnaît là le côté très mutagène de l’indus, permettant de diversifier les ambiances et les rythmes pour faire plus ou moins ce que l’on veut. On ne prétendra pas que le style est véritablement réinventé avec cette première incursion dans le genre, mais on a au moins droit à quelques chouettes variations entre les dix titres (onze en comptant l’intro). Ainsi le single « Taste My Hell » est très NIN dans son instru, et très Manson dans son chant. Le tout étant plutôt costaud tout en gardant un côté émotionnel fonctionnant assez bien. La plage tutélaire est quant à elle plus brute, plus crue. Plus directement « indus » dirons-nous. Avec un peu de reverb rajoutant un aspect éthéré à l’ensemble, avec en plus un refrain assez diablement entraînant. Alors que « That Fog » est plus minimaliste, plus lourd, plus « martial ». On ne va pas faire toutes les pistes, mais disons qu’il y a à boire et à manger et que ça ne donne pas mal du tout, surtout pour une première d’un artiste touche-à-tout (bien qu’il ne s’agisse pas d’un one-man-band, contrairement à ce que son nom voudrait faire croire !). Ce n’est pas encore parfait, il manque sans doute de titres vraiment mémorables, mais on salue la prise de risques. À voir maintenant si on aura droit à un second essai pour sublimer l’ensemble ou bien si, au contraire, Monsieur Borsellini tentera encore quelque chose de différent par la suite. En tout cas, son parcours est digne d’intérêt.
SAVAGE BEAT - "New World"
Je n’ai pas souvenir de chroniques de ma part honorant le travail d’artistes néerlandais. De Belges néerlandophones, certainement. Mais mes connaissances de la scène musicale des Pays-Bas s’arrêtent beaucoup plus au sein des genres très divers d’electro (plutôt véloce et crasseuse, de l’ordre du gabber et assimilé) que du metal, du rock ou dans le cas présent : du punk. Mais comme on a déjà pu longuement vérifier que l’envie de gueuler, faire la fête et parler de ses problèmes ne connaît pas de frontières, il parait bien malencontreux de partir sur de quelconques préjugés à l’ère où toute la musique du monde et de toutes les époques est à une portée de clics. Et donc, que donne ce premier EP, sortant sur l’aptement nommé « Rebellion Records » ? Et bien ça groove sévère ! On est sur quelque chose d’assez facile à appréhender, de plutôt agréable à passer dans sa voiture de manière posée. Les plus puristes trouveront à râler en affirmant qu’on se retrouve moins dans le punk d’antan, pur jus, avec des voix éraillées, de la grosse disto et une production dégueulasse qui fait le charme… Mais inutile de faire une division binaire entre « vieux » et « nouveau » punk, ce serait précisément antipunk ! Parce que la charnière située fin des 90 s/début des 2000 s regorgeait de groupes intéressants, peut-être plus radiophoniques, mais dont les valeurs et les messages n’étaient pas (toujours…) édulcorés pour parler de grosse teuf, de chagrin d’amour ou de désobéir aux parents uniquement. On pouvait aussi parler de la peur de l’inconnu approchant, de l’ennui d’une banlieue calme ou de ses doutes. Et c’est peut-être ça la grande force du punk : pas tant de pouvoir faire « n’importe quoi », mais surtout de pouvoir faire « tout ». Et si l’on ne prétend pas non plus que Savage Beat réinvente la roue pour proposer l’avant-garde de la troisième vague du punk, on se dira qu’un album nommé « New World » en plein milieu de pandémie n’a sans doute rien d’anodin… Pas convaincu ? Est-ce que des noms aussi équivoques que « Trapped », « Killing Time » ou « All Bars in Town » laissent toujours place au doute ? (Sur) interprétation personnelle ou pas, les cinq titres tombent en tout cas clairement à pic. Tant pis pour les éternels insatisfaits : le riff de « League of Fools » ainsi que ses chœurs sont trop bons et accrocheurs pour bouder son plaisir. Le bridge du titre qui ouvre l’album aussi. Et de façon générale : en à peine un gros quart d’heure, Savage Beat apporte une patate d’enfer et une grosse banane sur notre visage. Dernière interprétation et puis j’arrête : peut-être doit-on y sentir un énième parfum de nostalgie, si tenace qu’on le sent partout, mais qu’on ne peut s’empêcher d’accueillir dans nos narines de temps à autre. Car oui, ce petit goût de jeux de bagnoles ou de skateboard sur PlayStation 2 n’est peut-être pas étranger à cette critique dithyrambique. Mais je reste confiant sur le fait qu’il est impossible de vomir un tel EP, si débordant d’énergie et de bonne humeur. Tout n’est pas objectif… Mais il est subjectivement impossible de ne pas taper du pied avec « New World » ! Du coup, leur nom ne paye peut-être pas forcément de mine (on imagine davantage un qualificatif pour un sample plutôt pas mal qu’un groupe de petits gars survitaminés), mais leur musique est plutôt efficace et même assez propre pour un genre aussi abonné au DIY au point d’en faire une religion. À voir s’ils ont gardé quelques cartouches pour l’après-pandémie. On est en tout cas assez impatients d’avoir un album plus long, un poil plus varié et ça fera complètement mouche !
LA FIN - " Endless Inertia"
Imaginez ma surprise en recevant l’album du sextuor (un mot qu’on n’utilise pas souvent ça) et en découvrant un côté black assez présent et totalement assumé… Loin d’être un défaut, bien entendu, surtout lorsqu’il est bien fait. Et surtout, cela m’apprendra à me rattacher avec tant de véhémence aux petites cases que constituent les genres (quoiqu’en faisant son vieux con, on pourrait dire que la présence de vocals éloigne du post-metal stricto sensu, mais c’est de la mauvaise foi). Bref, encore une raison d’aimer les Italiens et leur propension à sortir des morceaux riches, complexes… longs ! Une véritable obsession à ce stade. Et pourtant, rien à voir avec les sonorités oniriques plongeant l’auditeur dans un état de transe et la douce poésie des quelques autres groupes et albums découverts cette année. Ici, les influences sont clairement à trouver dans le metal extrême et assimilés : outre le black et le post déjà abordés, rajoutons un soupçon de hardcore et peut-être une pointe de doom ? Un brillant melting pot, une fois encore maitrisé impeccablement. Est-ce que c’est le fait de s’être entouré de beau monde depuis leurs débuts, en ce compris lors de l’enregistrement de ce premier album ? Le fait d’employer TROIS guitares ? Ou la fougue de la jeunesse, tout simplement. Peut-être un peu de tout… et là aussi, un melting pot gagnant. Rajoutons en plus que les lascars pensent déjà à la suite, au point de considérer « Endless Inertia » comme un teaser, une mise en bouche. Une sacrée vantardise qui fait espérer beaucoup ! Mais pour l’instant, toute l’attention revient à ce premier opus, fort sympathique, fort dynamique et généreux, qui cache un bel élan de lyrisme tout de même pour quiconque ose creuser et percer la carapace abrasive de « La Fin » (qui termine même son album par une « Eulogy »… En plus, ils ont de l’humour !). Et justement, le mot de la fin… c’est d’aller y jeter une oreille curieuse et attentive. Pondre de tels albums d’emblée, ça n’arrive pas systématiquement.
THE BATES - "Unfucked Live"
Cette chronique cristallise plusieurs remarques transversales faites au cours de nombreuses critiques passées de votre serviteur. Pour Die Grüne Welle et Serum 114, je questionnais par exemple la scène punk allemande, d’apparence très intéressante, mais très méconnue au détriment des deux mastodontes britanniques et américaines (et chez nous, un peu franco-belge aussi). J’évoquais lors de de multiples chroniques de post-punk ou de prog telles que pour San Leo, Plight Radio ou Threestepstotheocean la longueur des morceaux, au point d’affirmer qu’il serait plus simple de parler de « passage » préféré plutôt que de titre. Enfin, dans ma récente chronique sur le dernier né de Bearings, les nombreuses « écoles » du punk étaient rappelées, avec le côté fun, revendicatif, référentiel, nerveux ou émotif. Et c’est avec un certain amusement que les pensées se bousculent à ce sujet : vingt titres, dont certains ne font qu’à peine plus d’une minute. Un exemple parfait de la scène punk allemande. Et surtout : un style résolument old-school et pour cause : il n’y avait que ça à l’époque. Car après cette intro bien trop longue, il faut mentionner le plus singulier et remarquable de cette ressortie : l’originale a vingt-sept ans ! Et le groupe lui-même n’existe plus depuis presque deux décennies. Et c’est sans doute là que l’idée d’une ressortie prend tout son sens : vouloir célébrer un groupe potentiellement oublié, remettre au goût du jour une musique que toute une génération ignore. Et le fait qu’il s’agisse d’un live, en pleine pandémie et alors qu’un show punk est une véritable expérience entre blagues vaseuses, échanges de chopes et côtes cassées… y’a un côté doux-amer qui se mêle à la nostalgie. Il convient d’éviter l’hypocrisie en reconnaissant que oui, là aussi comme pour Bearings, ça traite beaucoup d’amour… Mais absolument pas de façon analogue ! Chez The Bates, on parle plutôt de filles. De celle que l’on déteste, celle dont l’amitié est moins bien que le béguin, mais mieux que le vide, celle qu’on aimerait se faire… Loin du côté un peu larmoyant des groupes plus pop qui suivront. Y’a des chansons s’apparentant à de grosses vannes. D’autres qui permettent de se la péter en gueulant très vite pendant une minute trente presque sans reprendre son souffle, ou de jouer de la guitare bardée de grosse disto, juste pour voir. En ce sens, les vingt morceaux sont très variés et s’enchaînent rapidement et logiquement, rien à redire. On pourra même chipoter un peu en se disant qu’avec des titres d’une ou deux minutes, ça fait un peu court le concert… Mais l’énergie est si communicative qu’on sera juste heureux de voir un tel vestige subsister et ressortir aujourd’hui. Et si cette chronique copieuse ne semble s’adresser qu’à ceux souhaitant revivre des souvenirs ou aux curieux, désireux de découvrir à quoi ressemble le punk allemand, on veut adjoindre une troisième catégorie : les kepons tout court. The Bates se payent même le luxe (contrairement à leurs compatriotes susmentionnés) de chanter majoritairement en anglais. Alors aucune excuse pour ne pas redécouvrir ce groupe culte, et ses tout de même DIX albums.
VIKING QUEEN - "Hammer of the Gods"
Vous souvenez-vous de cette drôle d’époque d’internet où tout était qualifié « d’epic » ? Phénomène assez inexplicable s’apparentant plus ou moins à un synonyme de « cool » ou de « génial », on le casait pour un peu tout et rien. Et dans le cadre de la musique de Viking Queen… On doit admettre que c’est un peu ça aussi, à moins qu’il ne s’agisse d’un pléonasme ? Le Heavy, genre pionnier et très métamorphe à ses débuts, a une belle proportion de groupes lyriques et grandiloquents et en ce sens, Viking Queen ne paraît pas se démarquer outre mesure. Là où on sera peut-être légèrement plus surpris, c’est dans le fait de retrouver de la mythologie nordique (à l’ancienne donc, où le folk et le power n’avaient pas encore tout grignoté !), mais également d’y retrouver une voix féminine. On aimerait ne plus avoir à en faire un argument coup de poing, mais ça fait toujours rudement plaisir d’entendre le travail de musiciennes. Dernier élément, et non des moindres, c’est le côté assez sentimental de l’album, semblant presque proposer une succession de balades entrecoupées de quelques riffs hargneux alors qu’on a davantage l’habitude de l’inverse. Le morceau « Knives through my heart » (l’un des meilleurs de l’album d’ailleurs) aurait clairement pu clore un album de Heavy classique. Ici, c’est le troisième titre de l’album. On retiendra par conséquent surtout cela de cette première production de Viking Queen : une voix magnifique, un rythme plus posé… qui n’excluent malheureusement pas une courte lassitude en milieu de parcours. C’est que malgré ces petites touches perso, cela reste du heavy plutôt convenu. Bon, mais pas transcendant. Nul doute que selon votre niveau de fanatisme, l’album récoltera un demi-point de plus ou de moins. Nous choisissons donc de couper la poire en deux.
BEARINGS - "Hello, it’s you"
Commençons par une digression : l’artwork est absolument magnifique. Onirique, surréaliste, pastel… Il fait forte impression. Et on se demande si ce n’est pas pour cela que le quintet l’a choisi, plus que pour « illustrer » leur musique. Quiconque suit mes chroniques depuis un moment sait que je ne porte pas le pop-punk dans mon cœur : le genre me parait souvent trop creux et superficiel, parlant de problèmes un peu légers, bien que très humains. Un plaisir coupable m’anime quant aux groupes plus hargneux, plus axés sur la crise d’adolescence que les déceptions amoureuses… et encore plus pour les groupes qui ne se prennent pas au sérieux et qui peuvent faire un titre prônant leur fanatisme envers une personnalité ou exprimant une galère du quotidien (quand ce n’est pas une simple invitation à boire comme un trou et faire la fête). Malheureusement pour moi, Bearings se situe plutôt dans la catégorie mièvre… Nul doute que cela plaira à toute une tranche d’aficionados, mais voir une bonne moitié des morceaux traitants d’amours imparfaits, perdus ou déplorables, fini par être lassant, surtout lorsque les paroles ne se démarquent pas de celles de la palanquée de groupes du même acabit. C’est nettement cynique, mais aborder ses expériences passées est une solution de facilité, certes qui marche toujours bien, mais qui témoigne d’un certain défaut d’inventivité. Rassurez-vous cependant, il s’agit en fait de l’unique critique réellement négative (et encore, fortement subjective) de l’album. Certes, il manque un peu de peps, mais cela ne semble pas être la dynamique poursuivie non plus. Il fait le café, clairement, et les instrumentales, bien que sans véritable éclat non plus, sont tout à fait correctes. Votre avis dépendra donc grandement de ce que vous recherchez : les jeunes adultes languissants de leurs années lycée y retrouveront sûrement de très bons souvenirs. Les autres se diront qu’il s’agit « juste d’un album de plus ». Agréable en écoute passive, sympa au milieu d’une playlist, mais assez oubliable en dehors peut-être des fans les plus chevronnés.
SHORES OF NULL - "Beyond the Shores of Death and Dying"
Et dire qu’on s’amusait du dernier opus de San Leo et de ses deux titres de plus de vingt minutes… Je pense qu’on ne fera pas plus outrancier que le morceau unique de Shores of Null (à moins de caser l’intégralité d’une discographie sur un seul et unique disque ?). Trêve de plaisanteries nulles, il s’en passe des choses tout du long de ces 38 minutes, qui prennent par moment des relents de black ou même de grunge ! Passant du chant growlé au chant clair, de mélodies lancinantes et calmes à des pics de vitesse et de force. Il paraît délicat de vous spécifier des extraits de l’album autrement que par « début, milieu, fin », alors retenez que le morceau est d’un équilibre effarant. Avec une telle durée, il aurait été aisé de craindre quelque chose d’interminable, de long ou de lent… Ou peut-être au contraire, un titre partant dans tous les sens, ne sachant pas où il va et finissant par perdre l’auditeur. Il n’en est rien. C’est un travail méticuleux que propose le quintet. Chaque passage est à sa place et si certains éléments reviennent périodiquement, c’est toujours à bon escient et au bon moment. Rien ne paraît décousu ou répétitif. Et s’il est amusant de parler de « moment préféré » pour qualifier ce genre de morceau très long, cela semble presque malvenu ici (comme pour San Leo, encore une fois) : couper dans le lard pour avoir plusieurs morceaux liés entre eux n’aurait que peu d’intérêt, précisément à cause de ces passages répétés, mais aussi de la progression cohérente et naturelle du titre. Oui, c’est long, oui c’est un format peu commun… Mais on ne le verrait pas fait d’une quelconque autre manière. Un bel exercice de style, qui se démarque des deux précédents albums du groupe, au format plus classique… mais à la musique tout aussi sublime et sombre. Lors d’une précédente chronique, je plaisantais sur l’attrait apparent de l’Italie pour la musique progressive, où les instruments et l’atmosphère ont la part belle (post-rock, psyché, doom…), et ce n’est pas Shores of Null qui me persuadera du contraire. On ne s’en plaindra certainement pas : le résultat n’est pas des plus accessibles, mais il frappe directement nos sentiments de manière presque primale. À écouter au casque et au clame !
BYSSHE - "Forever in the Eye of Change"
Déjà évoqué dans deux précédentes chroniques, le label M&O Music nous enthousiasme de plus en plus avec ses groupes créatifs et originaux. Cette fois-ci au programme : un curieux mélange psyché/folk qui attise forcément l’attention. Je l’avoue : j’ai un faible pour les singularités, surtout quand le bilan vient estomper d’éventuelles craintes d’un résultat bancal ou trop étrange pour son propre bien (ou pire encore : quand on tente un fourre-tout visant à appâter tout le monde). Ceci étant dit, où est le psyché, où est le folk rock ? Et bien sans exagération : ça se retrouve un peu sur chacun des sept titres, qui déploient malgré tout des atmosphères originales. Le titre « Constellations » est légèrement plus pêchu, alors que le morceau « Love and the Moon » sent bon le soleil et les vacances… quoi de plus approprié avec le froid approchant ? Tandis que « Toward Glastonburry » martèle son identité folk avec vigueur, « Epipsychidion » (à vos souhaits) ressemble à un voyage onirique. Ils ne nous mentaient pas en évoquant leurs inspirations poétiques et le spleen animant leur musique, d’ailleurs pour l’anecdote, le nom du groupe provient du poète anglais « Percy Bysshe Shelley »… Ce n’est pas une mouvance que l’on retrouve chez tous les groupes ! Mais le résultat est saisissant et envoûtant, et c’est même rassurant de voir que la chanson peut encore être tout simplement… belle. Pas forcément triste, énervée, revendicatrice ou raconteuse de vie. Il y a encore des titres magnifiques de façon intrinsèque, sans devoir passer par le full instrumental pour forcer les gens à se déconnecter et à écouter. Nul doute que le duo de voix aura, en ce sens, joué un grand rôle. Ils mettent déjà la barre bien haut avec seulement deux albums… Hâte de voir où leurs idées les mèneront ensuite.
VESTA - "Odyssey"
L’une des grandes découvertes de 2020 pour votre serviteur, c’est clairement la scène post-rock italienne. Elle est d’une jeunesse vigoureuse, d’une pluralité riche et d’une poésie très plaisante. Pour Vesta, il s’agit déjà de leur deuxième opus, et il donne très envie de redécouvrir le premier. Comme il est de rigueur dans le style, le groupe déploie des mélodies très hétérogènes sur chaque morceau, qui pourtant se montrent lancinantes, répétitives… et par là même, envoutantes dans leurs motifs, leurs patterns. Dans la quête toujours plus fascinante d’expérimentation, également caractéristique de tous les genres en « post… », on trouvera ici une place assez importante de la basse par exemple, en attestent des titres comme « Breach » ou « Borealis ». On saluera aussi le côté plus lourd, plus franc des instruments que dans nombre d’offres du style (d’où le sobriquet de « post-metal », lui collant finalement assez bien). Très atmosphérique, très polymorphe et proposant un cran de puissance, de vitalité sans être brutale ou violente. Ce sont peut-être ces morceaux moins électroniques, plus « durs », plus « metal » qui pourront plaire à une audience moins habituée… Tout en ne perdant pas ceux qui apprécient être transportés par la douceur des rythmes de « Tumae » ou « Supernova ». Une excellente pioche, pour un tout aussi remarquable exemple du savoir-faire italien en la matière.
SAN LEO - "Mantracore"
Alors qu’une précédente chronique s’amusait de la nécessité des fans de prog à citer des PASSAGES favoris plutôt que des titres, San Leo ne facilite absolument pas la tâche. Deux titres seulement, chacun de plus de vingt minutes, et croyez bien qu’il s’en passe des choses en autant de temps, confirmant une fois encore le côté très « fourre-tout » du genre post-rock (et l’amour passionnel qui l’unit à l’Italie, accessoirement). Le duo, qui se réinvente beaucoup au gré des albums, nous propose ici une musique moins riche que complète (les deux n’étant pas mutuellement exclusifs, loin de là). On croirait presque qu’ils aient voulu jongler avec tous les codes : entre des rythmes mystiques presque tribaux mêlés à des riffs violents, au formidable travail sur les percussions et ce côté éthéré si cher à ce genre des plus planants… Il y a beaucoup de matière. Plusieurs fois, on s’attend à ce que le morceau s’arrête… Alors qu’il reste en fait encore quinze, douze, dix minutes d’une véritable expérience sonore quasi-synesthésique. S’il n’est pas rare de se projeter images et scénario en présence de musique, la grande force de San Leo est de nous permettre d’imaginer un film entier, avec ses hauts et ses bas, ses accalmies et ses moments culminants. On aurait sans doute pu diviser, fractionner les deux titres comme pour « compartimenter » leurs temps forts, les réécouter indépendamment voire les réarranger. Mais cela aurait finalement autant de sens que de changer l’ordre des scènes d’un film : pour un résultat tantôt amusant, tantôt surprenant… Cela n’aurait jamais autant de saveur que de l’expérimenter de la façon dont l’auteur l’a voulu. Et en tant que telle, plus encore que d’habitude, une oreille active et immersive est une nécessité. Nul doute que ça n’en fait pas l’album le plus facile à écouter en boucle, ou même le plus radiophonique. Mais comme toute expérience un peu à part, un peu « englobante » voire « envahissante », elle mérite une attention particulière… que l’on appréciera revivre après l’avoir laissé décanter un petit peu !