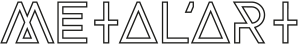Ale
MALOTA - "The Uninvited Guest"
Crevons directement l’abcès : le keupon exigeant que je suis ne retrouve pas tellement mon genre fétiche dans l’EP de Malota, et ce malgré des titres plutôt entraînants et gorgés d’adrénaline (et surtout un titre nommé « Anti-Social »… ça ne s’invente pas !) Maintenant que j’ai fait mon chieur, nous pouvons commencer.
« Lampedusa » nous claque la joue d’emblée, avec de gros riffs bien sales en guise de mise en jambe et une batterie simple, mais bien mise en avant. Plus surprenant : au milieu du titre, la guitare semble « engluée » et le tempo diminue. Elle est plus traînante, tandis que le chant se fait plus énervé. « Anti-social » rajoute un cran de vitesse et une basse plus marquée pour un titre plus « punky » malgré des refrains où la guitare traînante fait son retour. « Ministers of Fear » est peut-être la chanson où la basse est la plus affirmée, tandis que le chant est le plus fracassant. Le tout formant une mélodie duelle : à la fois véloce et puissante lorsque la voix et la guitare prennent la main, et au contraire plutôt groovy lorsque c’est la basse qui règne en maître. La fin du morceau ralentit fortement, devenant une sorte de proto-doom étrange… Mais pas désagréable, avant de repartir sur un refrain toujours aussi dévastateur. « The Queen, The Lady » rajoute une bonne couche de basse avec un chant cette fois plus clair, pour un titre toujours aussi explosif, mais qui lui aussi se permet des changements de rythme audacieux. Et la chanson éponyme qui clôt l’album ? Elle envoie tout ce qu’elle a dans le ventre ? Oui et non : disons qu’elle est plus haletante, et plus facile d’approche aussi, avec une guitare plus « bondissante ». Mais reste dans la lignée de ses consoeurs avec ses changements de rythmes fréquents. Le tout se finissant de manière un peu abrupte, sans grande fioritures.
C’est un peu ce qui caractérise cet EP en fait, dont on ne sait pas exactement dans quel sens le prendre alors qu’il ne part pas dans des délires créatifs excessivement poussés. Si ce n’est quelques variations de rythmes et un chant fluctuant, il reste grosso modo dans les clous et on apprivoise ses méthodes au bout des 2-3 premiers morceaux. Et ça le rend presque frustrant à critiquer puisque, d’une part, il n’a pas une structure commune et sur-poncée. Et d’autre part, il ne fait rien de véritablement incroyable non plus. C’est ce genre d’album un peu tristoune qui n’a rien de fondamentalement mauvais, mais sur lequel on ne peut rien dire de réellement bien ou de marquant non plus. Il existe, simplement.
Alors oui, y’a quelques os à ronger pour le bassiste que j’incarne, et une bonne énergie qui donne la patate sur chacun des cinq titres. Mais le reste demeure franchement quelconque.
EVERY TIME I DIE - "Radical"
À la réception d’un album, d’autant plus d’un groupe que je ne connais pas ou peu, il m’arrive fréquemment de grappiller mes premières infos sur ce qui m’attend via le genre énoncé, le titre de l’album, sa pochette et le dossier de presse fourni. Cela donne une première carte mentale, un avant-goût, une « couleur » de l’univers de l’artiste et de ce qu’il entend proposer. C’était d’autant plus important ici que si je suis pointilleux sur certains genres (typiquement l’indus, le thrash ou le heavy), il y en a d’autres où je patauge totalement tant j’y suis étranger. Le metalcore en fait partie. Et la pochette, avec son esthétique vaporwave et son titre au parfum de 80s non plus. Pas moyen d’y échapper : fallait y aller à l’aveugle !
Et l’expérience fût des plus plaisantes finalement. Comme il est jouissif de tomber sur une pépite insoupçonnée (parfois même jusqu’alors totalement inconnue), cet opus vraisemblablement attendu d’Every Time I Die m’a charmé. Sans doute parce qu’il a une charpente un peu thrashouille et hardcore. Les Buckley's sont absolument déchaînés et se donnent pour mission de nous faire aucun cadeau pendant chacun des seize morceaux répartis sur cinquante-et-une minutes (à l’exception, peut-être, de « Thing With Feathers », sorte d’accalmie aussi surprise que bienvenue dans cet océan de rage bouillonnante ! Elle est douce et magnifique) Aucune crainte à avoir non plus du côté du jeu de « Goose », leur nouveau batteur : il fait le café de fort belle manière, notamment sur « Desperate Times » ou « We Go Together ». La plume de Keith est incisive et nihiliste, torturée même et s’illustre à bien des occasions comme sur le titre susmentionné, mais aussi « The Whip » ou « Post-Boredom » (d’une efficacité sans pareille d’ailleurs !), tandis que les guitares nous fracassent sur « All This And War », « Distress Rehearsal » ou encore sur le sobrement intitulé « Planet Shit ». Nous avons eu l’occasion d’entendre maintes fois ces deux dernières années à quel point les zickos étaient énervés, sur boostés… non pas sans raisons et sans doute d’autant plus du côté américain. Mais ETID va encore un grand au-dessus : totalement habituel, selon bien de mes confrères. Pratiquement une marque de fabrique du genre, si j’en crois mes maigres connaissances. Mais tout de même, une telle soif de sang alimentée par un magma de colère tout du long mérite d’être soulignée. On regrettera tout juste (et c’est un détail) cette générosité : peut-être qu’un titre ou deux auraient pu passés à la trappe. Non pas pour leur qualité ou une quelconque faiblesse, mais plus pour laisser l’opus respirer, le décharger un brin. Mais ce serait sans doute hérétique de le suggérer aux fans, surtout après cinq ans d’attente depuis « Low Teens »
Une vraie petite bombe en somme, et une occasion en or pour moi de mieux creuser le sujet. Chapeau bas ETID ! Deux ans après ma chronique du « All Hail » de Norma Jean, vous confirmez qu’il existe un monde de découvertes qui m’attend encore.
E-FORCE - "Mindbender"
Pendant un cours instant avant réception du dernier album d’E-Force, mon passé en tant que fan d’electro néerlandaise (et de hardcore/hardstyle pour être plus précis) a ressurgit : qu’est-ce qu’il venait faire chez Metal’Art celui-là ? Mais il n’en est rien, puisque l’on parle en vérité d’un groupe de thrash vieux de vingt ans et riche de son cinquième album. Groupe sur lequel je suis passé totalement à côté pendant tout ce temps (au contraire de Voivod, son grand frère, duquel Eric Forrest semble avoir bien du mal à se défaire).
Est-ce que j’éprouve quelques regrets à être passé à côté, grand fan(atique) de Thrash que je suis ? Il faut bien dire que oui, d’autant plus qu’E-force (en tout cas sur cet album, j’ai de la matière à rattraper) semble être une bestiole bien particulière dans le genre très peu mouvant du Thrash metal. Je me dois d’ailleurs de faire un second aveu : lors de ma première écoute, j’ai dû digérer l’album en trois séances distinctes, tant je me sentais submergé par ce que j’étais en train d’écouter. Est-ce que je m’encroûte ? Est-ce que je n’étais pas dans de bonnes conditions ? Est-ce que je n’étais tout simplement pas prêt ? Je laisse cela à l’appréciation de chacun ! Toujours est-il que j’ai dû reprendre mes esprits en réponse à ce que je me prenais en pleine face. La seconde écoute a pu se faire d’une traite, sachant à quoi je pouvais m’en tenir. Elle fût d’autant plus éclairante.
Avons-nous là un album démentiel, d’une originalité hors-normes et franchement violent ? N’allons peut-être pas si loin ! Mais il s’écarte tout de même du Thrash pur et dur. Bien sûr, il reste belliqueux, il reste puissant et rapide, il propose des riffs inventifs prenant leur plein essor lors de bridges aussi fréquents que délicieux. Mais il propose aussi quelques éléments bien à lui : la voix aiguë et éraillée de son frontman, qui n’est pas un cas unique, mais reste une agréable surprise, surtout sur un album ENTIER. Le tempo est aussi régulièrement plus lent, comme pour marquer une atmosphère plus lugubre et impacter davantage de ses instruments. Ce côté ambiant se décuple sur un titre comme sur « Futures Past », entièrement instrumental et tranchant encore davantage avec ce que le thrash nous livre usuellement. Enfin, certains riffs, certaines mélodies semblent plutôt sorties du monde du heavy, voire certaines expérimentations que ne renieraient pas l’indus ! Avec cette jaquette biomécanique et une totale méconnaissance du sujet, je dois dire que cela ne m’aurait guère étonné qu’ils s’insèrent encore davantage dans cette optique.
En clair, E-Force m’a procuré des sensations que je n’avais plus ressenties dans le Thrash depuis fort longtemps. Bien sûr, les bonnes surprises ne manquent pas… Surtout ces dernières années. Entre vieux pionniers toujours dans le coup et jeunes rejetons bien inspirés, il y a à boire jusqu’à plus soif pour le thrasheux invétéré. Mais est-ce vraiment novateur ? Cela devient rare. On a bien Cryptosys qui s’épanche en science-fiction plutôt que les thèmes classiques de guerre, de religion et de politique. On a bien On a bien Nightmare, groupe de power-heavy français dont le dernier album Aeternam avait quelques relents bien thrashouille (et qui surtout peut se targuer d’être l’un des, trop rares, groupes du genre à avoir une chanteuse). Mais au-delà de ça, on finit par avoir l’impression d’avoir un peu fait le tour. Donc lorsqu’un groupe comme E-Force débarque, on se tait, on prend le temps d’écouter (même en plusieurs fois !) et on savoure. Une belle découverte… et comme une envie de rattraper le temps perdu.
GAAHLS WYRD - "The Humming Mountain"
À la lecture du titre de l’album et du genre dans lequel officient les norvégiens, je ne m’attendais pas réellement à quelque chose d’aussi varié… Et fracassant ! Le quatuor sort en effet, de leurs modestes mots, un « petit » album…c’est-à-dire pas un EP et pas un vrai album non plus, un objet dans l’entre-deux ! Et il faut dire qu’avec un peu moins de trente minutes de musique, nous avons en effet quelque chose de plutôt riche. On commence avec « The Seed », qui fait à lui seul près d’un tiers de l’album et se veut planant, posé, atmosphérique. La plage tutélaire vient lui ajouter du macabre, du dramatique tout en restant lancinant. « The Dwell » rajoute une batterie explosive et des riffs plus rapides, donnant très énergique. « Awakening Remains… » devient alors l’apogée, le point culminant où tous les instruments s’emballent dans un brouhaha grandiose. Seul le dernier titre, « The Sleep » déçoit un peu par sa fin très abrupte, n’apportant pas de réelle conclusion au microcosme de l’album. Il apporte néanmoins une accalmie bienvenue, sorte d’instant d’introspection suite à l’histoire qui vient de nous être contée. Mais si sa fin déçoit, le groupe semble déjà plancher sur un autre mini-album… Nul doute qu’il fait office de teaser en ce sens, de première partie. Nous avons hâte d’en découvrir la suite !
NON RESIDENTS - "Against Police Brutality"
Si le titre de leur premier album n’est pas suffisamment équivoque, nul doute que leur premier titre, simplement baptisé « Intro », va vous mettre au parfum : ça gueule « ACAB » d’emblée, et pendant près d’une minute ! C’est qu’on n’a pas manqué de malheureux exemples de violence policière américaine ces dernières années, et pour des chiliens fraîchement expatriés, on ne peut qu’imaginer que la vie new-yorkaise n’a pas dû diminuer ces mauvaises impressions, que du contraire. Sans surprise, lorgner du côté du hardcore pour exprimer injustices et colères n’est pas fortuit.
Si le premier « vrai » morceau se place comme une présentation de ce juvénile quatuor (là aussi, « We Are Non Residents » laissant peu de place au doute, même pour quelqu’un qui parle anglais comme une vache espagnole), très vite, on se rend compte du poids qui pèse sur nos comparses : « Resilience », « Comfortably Tied », « Not For Me » sont autant d’appels à l’aide que de brûlots nécessaires. Et si le clin d’œil au titre controversé de Childish Gambino « This Is America » est possiblement une affabulation personnelle, l’occasion serait que trop belle que pour croire qu’il ne s’agisse que d’une coïncidence.
Et musicalement alors ? Et bah ça envoie pas mal, comme il est attendu sitôt que l’on joue avec ses tripes et avec toute l’honnêteté du monde. Rapide et puissant, leur musique ne se prend pas les pieds dans le tapis comme certaines formations qui, certes, ont beaucoup sur le cœur, mais une formation musicale peut-être encore trop faiblarde. Ici, c’est carré et endiablé, tout en n’oubliant pas d’être appréciable en tant qu’objet auditif, en tant que chanson que l’on veut gueuler autant que l’on veut voir nous titiller les tympans. On veut cogner autant que l’on veut taper du pied, et cerise sur le gâteau : on se tape en plus une idée plus géniale qui consiste à rajouter des rythmiques traditionnelles Mapuche (peuple autochtone du Chili et d’Argentine) à l’ensemble. Si aux oreilles du non-initié (dont je fais partie), cela ressemble à de la flûte, cela ne doit pas vous faire fuir pour autant, que du contraire : cela n’a rien d’un gadget ou d’une simple volonté de se démarquer. C’est une part que l’on imagine importante de leur identité, personnelle comme musicale, et on ne peut que leur implorer de garder cette idée sur de futures productions. « Brutal Caeca » et « Preludio » en sont ainsi garnis, et ça fait prendre de la grandeur à ces morceaux. Peut-être aurait-on aimé voir cela également au début de l’album, mais la sensation de surprise et de fraîcheur en aurait sûrement pâti. On se retrouve néanmoins avec des rythmiques entêtantes et quelques bridges bien thrashouilles qui font plaisir.
Je peux le dire sans trop sourciller : ce projet me touche énormément. Et c’est d’autant plus admirable que la forme est au moins aussi bonne que le fond. On aurait apprécié une poignée de chansons supplémentaires, mais pour un premier album, concocté en pleine pandémie en plus alors qu’ils espéraient tourner un peu avant… C’est de l’excellent travail. Hâte d’en entendre plus de la part de cette nouvelle référence de colère débridée, parce qu’assurément : le climat très tendu aux States aura au moins permis une résurgence punk de premier ordre, et de haute qualité.
CRIPTA BLUE - "Cripta Blue"
Argonauta nous a déjà prouvé être un bel incubateur à projets intéressants, et je n’ai de cesse de promouvoir la scène musicale italienne dans plusieurs de mes reviews… On commençait donc déjà très bien pour Cripta Blue. On y ajoute quelques beaux passages à la basse et des titres qui groovent bien, et clairement il n’en faut pas beaucoup plus pour me charmer. L’épisode « Magickal Ride » qui débute avec un enregistrement semblant promouvoir l’idée d’une formidable expérience post-mortem, s’illustre par une guitare musclée, un court mais sympathique passage à la basse et un bridge délicieux, avec en plus des paroles dans une lignée nihiliste, comme son intro. « Creepy Eyes » s’illustre de son côté par sa gratte et son groove, qui s’énerve après son premier tiers, pour devenir plus lourd et lent, plus percutant… Presque industriel même ! « Spectral Highway », portant décidément bien son nom, et plus atmosphérique et lugubre… Mais chill aussi. Il est doucereux et noir, porté par un chant qui l’est tout autant. Et puis, de temps à autre, une pointe de puissance vient arracher nos tympans et nous sortir de notre torpeur ! « Death Wheelers » fait augmenter encore d’un cran l’épouvante au son des « hell’s bells » et d’une guitare plus distordue que jamais. Le tout pour un titre plein de patates. Enfin, « A Space Tale », portant elle aussi bien son nom, ajoute un peu de cosmique à cet album fleurant déjà très bon toute la vibe rétro des années 60 et 70. Là on se tape un son plus caverneux, mais toujours porté par ce feeling duel entre la bonne gratte qui fait secouer la tête et cette basse qui nous caresse l’échine, donnant malgré tout beaucoup de rondeur à l’ensemble. Pour le bassiste que j’incarne, la voir à la fois plus présente et en même temps en harmonie avec l’ensemble sans qu’aucun instrument ne se fasse écraser…C’est un plaisir total ! Cela résumerait plutôt bien ce premier album je pense : un vrai plaisir d’écoute, qui même s’il n’invente pas trop, retrace plusieurs influences s’étalant sur près de deux décennies. Avec sa fort belle pochette qui lorgne du côté du bon vieux psyché/prog avec une pointe d’horrorpunk en plus, impossible de ne pas reconnaître un travail jusqu’au-boutiste dans leur démarche de proposer du neuf avec du vieux. Cripta Blue offre un opus très sympathique qui donne envie d’en avoir plus de leur part.
BLACK SABBATH - "Technical Ecstasy 2021 Remaster"
J’affirme souvent que tout l’intérêt d’un remaster peut provenir d’une envie de remettre au goût du jour d’anciens classiques, ou parfois d’offrir une seconde chance à un album sous-estimé ou mal-aimé. Dans le cas de Technical Ecstasy, le deuxième scénario est plus probable, tant la réception de l’album fût tiède à l’époque (et personne ne semble vraiment s’être levé pour lui redorer le blason depuis… et ça fait quarante-cinq ans quand même !). On peut le dire : même chez les fans absolus de la légendaire formation, on retient cet album davantage pour son artwork atypique, pondu par le non-moins mythique collectif Hipgnosis, qu’à ses titres. Quid après plus de quatre décennies ?
Il faut bien le dire, les fans avaient toutes les raisons du monde d’être déçus. Exit le doom, le macabre, le pesant, le lugubre : seul un écrin de poésie noire subsiste pour nous rappeler les premières armes du groupe qui a tout débuté et plonger le monde du rock dans la pénombre. Bien sûr, Sabbath ne se limite pas à une sensation de malaise et des textes lugubres, portés par un groove inimitable lors des bridges. La voix caractéristique d’Ozzy et le talent virtuose des trois instrumentistes sont parfaitement préservés, donnant un résultat qualitativement irréprochable. Non, ce qui dérange, c’est bien la forme. Et ça n’a pas tant changé avec le temps hélas.
Les contemporains autant que les pros s’accordent pour dire que la peur aurait gagné le groupe, alors que le punk explosait et que l’incroyable innovation de leurs premiers opus se tassait doucement. Les poussant donc, logiquement, à vouloir se moderniser… Au point de trahir leur son, leur essence, leur fanbase. Le fait d’avoir désormais autant de recul rend l’épisode « Technical Ecstasy » d’autant plus incompréhensible et dénotant avec le reste de leur discographie, pourtant très plurielle et riche en rebondissements. De nombreuses prises de paroles intervenues par la suite font état d’un groupe bien au fait sur la déception liée à cet album en particulier… Après, certains parleront d’excuses ou d’effet de masse. De l’eau à bien coulée sous les ponts depuis en tout cas, en atteste cette ressortie d’ailleurs.
La vérité, comme souvent, se situe un peu dans l’entre-deux. Non, Technical Ecstasy n’est pas un mauvais album ou un album raté. Non il n’est pas dénué d’intérêt, de sens ou de bons moments. En fait, son apparente légèreté est aussi une force, et le groove classique de Sabbath opère toujours bien, rendant le tout à minima sympa à écouter. Les thématiques abordées sont surprenantes et gardent une plume aiguisée. On retiendra même « It’s Alright » chantée par Bill Ward, rare exemple d’une chanson interprétée par un batteur ! Le résultat est loin d’être mauvais ou même médiocre, et pour un fan de Sabbath, c’est déjà une petite raison de retenter une écoute. « Dirty Women » est un autre titre mémorable, avec quelques riffs plutôt cools et un rythme bien péchu et aux relents plus hard. Son bridge est vraiment top !
Que dire encore pour clore cette chronique ? Sans doute rementionner qu’un remaster en 2021 d’un album si mésestimé atteste que le groupe entend faire la paix avec lui-même, ou alors qu’il n’a de toutes façons plus rien à perdre et s’en moque donc éperdument. Peut-être est-ce ainsi qu’il faut l’appréhender ? Avec l’intention d’une (re)découverte qui, comme d’autres après lui, ne laissera pas forcément de souvenirs impérissables, mais nous fera dire que ce n’était finalement pas si mal que cela. À mes yeux, Technical Ecstasy est l’équivalent du Turbo de Judas Priest : souvent justifiés par une sortie trop hâtive ou une envie de changer d’air mal exploitée, on dira plutôt qu’ils ont tenté de faire quelque chose d’autre qui ne leur ressemblait pas. Intéressant pour l’histoire, assez quelconque au sein d’une discographie à la fois si vieille et si fournie.
ANDREW WK - "God Is Partying"
Il s’en est passé des choses depuis la sortie de « I Get Wet » en 2001, mais beaucoup ont conservé ce souvenir profondément dans leur mémoire, au point d’ériger AWK comme un artiste certes drôle et énergique, mais vite répétitif malgré la patate folle furieuse qu’il nous assénait à l’époque. Mais avec un album intimiste au piano, un album plus grandiose et éthéré et tout un panel d’activités annexes et variées, il serait injuste de limiter le multi-instrumentiste à sa personne de « Party God ». Ce que le titre de ce nouvel opus n’indique pas… à tort. C’est en effet un sacré schisme qui s’opère chez AWK : toujours pleinement maître à bord, il fait péter le t-shirt noir (sacrilège !) pour proposer des titres lorgnant davantage sur des terres « metallisées », honorant son arrivée sur le label Napalm et tranchant nettement avec ses deux premiers albums, plus punks, plus simplistes. Ici les titres sont plus longs, plus sombres et plus hard. C’est un vrai volte-face créatif des plus rafraîchissants qui rappelle que AWK est fort d’une vraie et riche formation musicale, malgré des thématiques souvent légères. “God Is Partying” déplaira aux fans de la première heure, qui devront se faire à l’idée que l’époque « I Get Wet » est finie. Les réfractaires pourront dire que la forme est un peu convenue, donnant un métal sans grand relief malgré une indiscutable grandiloquence. D’autres enfin pourraient s’interroger sur la dimension religieuse de l’album, ou encore sur ses paroles parfois un peu nunuches. Mais tout cela ne peut occulter le simple fait que AWK est un artiste accompli qui prend là un énorme risque. On n’applaudira pas la forme à tout rompre : mais on fera une ovation à l’audace.
CONFUSED - "Riot"
Complètement foutraque, diaboliquement jouissif, cet album de Confused porte bien son nom et pas forcément de la manière la plus équivoque. Une haine anti-flic ? Un soulèvement contre l’oppression ? Y’a un peu de ça et bien plus encore ! En pure tradition punk, il y a également quelques titres festifs et bas-du-front à la « I Want A Beer » ou « Take A Bath », mais même ces derniers jouent avec nos nerfs pour libérer nos instincts primaires emmurés. Confused décoiffe, Confused dérange, Confused détonne. Le groupe nous tartine de dix-sept titres dépassant rarement les deux minutes et qui bougent le curseur au sein de plusieurs registres : parfois du punk californien plutôt entraînant malgré des textes revanchards, parfois du thrash de la même zone (et plus ou moins la même époque) pour garnir d’une armature plus musclée et puissante, cette base rageuse. Et ça c’est quand on ne vient pas même faire du pied au Death crasse, pour proposer un tourbillon de notes dissonantes, entre le bruit et la rafale de sons. Mais qu’on soit clair : c’est du chaos organisé. Ils ne gueulent pas juste pour gueuler, ni ne jouent avec la subtilité d’une grêle de coups de poings pour le plaisir de casser les oreilles des non-initiés. Le groupe est au contraire pleinement dans son élément et maîtrise amplement ses thématiques et sa musique : « Anger Issues » ou « Greedy SOB » suffisent à le prouver, tant elles sont curieusement sympas à écouter tout en ayant des refrains d’une efficacité insolente. Tandis que « Our Flag », « Love, Lies and Murder » ou « Hate In Me » traduisent des sujets certes chers au(x) genre(s), mais le font avec justesse et un plaisir coupable. Chaque titre ou presque fait mouche dans ce tableau bordélique, et s’il bouffe un peu à tous les râteliers, l’ensemble est étonnamment cohérent. Un comble lorsque l’on s’appelle Confused… Et qu’on ouvre notre album par un titre nommé « Chaos ». C’est finalement peut-être la traduction du monde tordu et imprévisible dans lequel nous vivons, et une énième preuve que les punks ont encore tout compris. Tant qu’il y aura un créteux pour gueuler l’étrangeté du monde, le genre persistera… Et l’inverse est peut-être aussi vrai. Rarement un album n’aura eu, presque physiquement, cette traduction de confusion profonde qui anime notre société, en tout cas au sein des vingt dernières années du genre. Alors certes, on regrettera sans doute le manque d’un ou deux ‘anthems’, d’un ou deux titres aptes à devenir des singles, des ‘tubes’. Mais sa légère difficulté d’accès fait sans doute partie de son ADN. Une formidable surprise, d’un groupe pourtant connu de la scène !
NANOWAR OF STEEL - "Italian Folk Metal"
Groupe parodique désormais très en vogue, la popularité de Nanowar of Steel s’est retrouvée catapultée avec leur précédent album, « Stairway to Valhalla » et plus particulièrement avec sa ressortie via Napalm. Les quelques singles « bonus », rajoutés entre la sortie initiale et cette réédition (« Valhallelujah », « Norwegian Reggaeton » ou le clip pour « Uranus ») n’y étant certainement pas étrangers non plus. Bref, on part sur une bestiole à la fois plus internationale que nos Ultra Vomit préférés, et plus moderne que les géniaux Tenacious D. Tout cela rend assez curieux ce choix de sortir un album dédié à la chanson italienne traditionnelle. Toujours de façon parodique bien sûr, mais tout de même : le risque de perdre son public, pas franchement informé sur le folklore du pays, paraissait réel. Malgré leur carrière plus que respectable, on ne peut pas franchement dire que J.B.O. s’exporte des masses hors pays germanophones !
Comment diable envisager une critique d’un tel album alors ? Et bien tout est dans son titre : en l’étudiant comme un album de folk ! Le genre étant coutumier de l’emploi de la langue maternelle pour toutes les parties chantées, cela rend subitement plus logique et appréciable de considérer les onze titres sous ce prisme plutôt que celui de l’unique déconnade. Pas besoin de parler finnois ou russe pour apprécier Korpiklaani ou Arkona, et même chose ici… Bien que cela atténue forcément la plupart des vannes (après, faut-il réellement de grosses connaissances en italien pour traduire « La Maledizione di Capitan Findus » ?). Ce qu’il faudra retenir, c’est que musicalement, ça envoie plutôt pas mal : c’est entraînant, c’est puissant, c’est fait avec le cœur. Nul doute que vous reprendrez plusieurs refrains en mode yaourt, juste parce que cette bande de rigolos y met énormément d’énergie. Puis bon, en Belgique francophone, y’aura sûrement un ou deux airs que vous reconnaitrez, si toutefois vous avez eu l’occasion de passer quelques soirées avec des italiens…
En bref, « Italian Folk Metal » est, en substance, difficile à recommander à quiconque ne parle pas bien la langue et/ou ne connaît pas bien le folklore du pays en forme de botte. Même pour un amoureux de folk, le résultat est si éloigné d’un projet comme Tengger Cavalry ou Ensiferum qu’il est difficile de vous encourager à y tendre une oreille : cela reste de la parodie, et donc une revisite presque totale des classiques. Reste alors, pour les fans les plus assidus, un album fonctionnel, respirant la bonne humeur.
MOTÖRHEAD - "No Sleep ‘Til Hammersmith"
Près de cinq ans et demi après sa mort, il est toujours aussi difficile d’accepter que Lemmy n’est plus des nôtres. Tout comme il est difficile de reconnaître que leur discographie prolifique s’est arrêtée presque aussi brutalement. Du coup, la moindre occasion pour rouvrir les poussiéreuses pages du livre Motörhead est une opportunité à saisir. Pour se souvenir. Pour redécouvrir. Pour réécrire la légende. Et cette ressortie de leur premier et fameux album live, pleine à craquer de bonus, est assurément une occasion de plus de rouvrir la porte des mémoires de la grande histoire du rock.
Commençons illico par le chipotage avant de laisser place aux éloges : avec quatre CDs pour presque autant de concerts, on a vraiment BEAUCOUP de contenu. Septante-et-un titres très précisément. De quoi en faire une petite surdose ! De plus, et c’est plutôt logique, plusieurs titres sont présents en double, triple voire quadruple exemplaires… Avec trois concerts, plus le soundcheck (oui oui !), plus l’album original remasterisé, on pouvait s’attendre à plusieurs versions du même titre. Autre curiosité : les concerts présents sont dans le désordre. En effet, le CD2 reprend le concert du 30 mars 1981 alors que le CD4 nous gratifie du concert du 28 mars de la même année… Très peu gênant en soit, puisqu’on se tape un groupe en forme olympique qui garde beaucoup d’énergie même après plusieurs jours de représentations consécutives, cela pose néanmoins question. Mais nos critiques s’arrêteront là.
Car au-delà de ça, on saluera précisément la qualité des enregistrements : très propres malgré leur âge, et permettant de profiter pleinement du groupe alors qu’ils venaient de sortir leur mythique Ace Of Spades. Chanceux sont ceux ayant eu l’occasion de les voir à ces moments de leur existence (j’étais alors bien loin d’être né !), alors que leurs excès autant que les affres du temps n’étaient encore que très très loin devant eux. Plusieurs fans font état de concerts très rudes, presque larmoyants, en fin de vie de Lemmy… Il est alors bon de se rappeler de l’énergie folle que ces gars-là déployaient pendant les décennies qui ont précédé. Outre l’ajout de trois titres en soundcheck, les 4 CDs proposent surtout une moitié inédite du concert de Leeds ET du concert de Newcastle du 29 mars ! Le concert du 30 mars 1981 ne comporte lui « que » sept titres jamais sortis… Ce qui correspond tout de même à près de 28 titres jamais sortis auparavant. Juste l’équivalent de deux albums en somme ! Comme précédemment énoncé, tout le contenu présent est pré-Iron Fist… Ce qui explique l’absence de nombreux classiques (et la répétition de plusieurs morceaux, certes mythiques, mais un peu redondants). Néanmoins, au milieu des « We Are The Road Crew », « Motörhead » et « Overkill », on est gratifié de chansons moins connues comme « Stay Clean », « Capricorn », « Fire Fire » ou « Jailbait ». Les premières années d’un groupe sont toujours magiques pour cette raison simple : les concerts écument réellement les fonds de tiroir pour tenir le public en haleine et éviter l’ennui. Exit donc l’espèce de best-of des singles millénaires que l’on reçoit à la tronche, presque par automatisme, en fin de carrière : ici, même les fans les plus assidus redécouvriront sûrement une chanson ou l’autre. Et ça c’est toujours plaisant pour sa playlist. Difficile de pousser plus loin cette chronique déjà trop longue : si ce quadruple album manque un peu de variété, de versatilité…Il le compense par une générosité et un confort d’écoute hors-pair.
Assurément, tout le monde à une expérience différente et des anecdotes variées sur le groupe. Découvrir le groupe avec « Ace of Spades » n’a rien de bien surprenant, tant le titre est omniprésent dans la culture populaire. Poursuivre sa découverte par le jeu atypique de Lemmy, en tant que bassiste, est déjà un tant soit peu plus respectable. C’est lui qui m’aura donné le goût pour les bassistes sortant du lot… et malgré tout, je parviens encore à me tromper sur la position du umlaut présent dans le nom du groupe. Motörhead fait partie de ces groupes à histoires, de ceux dont on a tous entendu au moins l’une ou l’autre chanson et qu’on peut ne pas aimer, tout en continuant à grandement les respecter. Cet album est, en essence, un énième produit posthume surfant sur l’héritage d’un groupe intemporel. Mais surtout, il appelle au souvenir et atteste d’une période déjà bien trop lointaine. Indispensable ? Peut-être pas. Bigrement généreux ? Totalement !
« We Are Motörhead… And we play rock’n’roll »
GOST - "Rites Of Love And Reverence"
À peu près deux ans après Valediction (chroniqué par votre serviteur, dieu que le temps passe vite !), l’âme tourmentée derrière le projet GosT nous revient avec un album à l’atmosphère aussi lugubre que l’album précédent était sensuel. Ce dernier à la pochette plutôt intrigante, inquiétante et esthétique à la fois, et aux titres aux relents gothiques et torturés, toujours avec un soupçon de romantisme. C’est que James Lollar, maître-architecte du projet, lorgne du côté de Priest, VR Sex ou Mr.Kitty plutôt que chez les Perturbator ou Carpenter Brut, figures de référence de la synth et d’autant plus par chez nous (rappelons, s’il le fallait encore, qu’ils sont franco-français !). Cette comparaison s’inscrit autant dans les thématiques que les sonorités, bien que leurs univers se frôlent sans jamais réellement fusionner. Et ce n’est pas plus mal.
Car même si GosT trouve sans doute moins les faveurs des metalleux (Perturbator et Carpenter Brut étant désormais habitués des festoches) ou des geeks (leur musique était présente dans les deux Hotline Miami), il touche un public peut-être plus vaste, plus ouvert aussi. Outre nos deux lascars, il a aussi tourné avec 3TEETH et, plus surprenant, Mayhem ou Power Trip. La synthwave a rapidement su s’extirper et s’éclater en dizaines de fragments parfois très différents. Si l’on avait tendance à regrouper tous les noms cités sous le terme générique de « darksynth », c’est sans doute lié à la fois à leurs sonorités généralement plus lugubres, brutales, rapides et écrasantes ainsi qu’à leurs paroles (quand il y en a) tantôt déprimées et vidées de passion, tantôt cryptiques, futuristes et langoureuses. Rien que ce terme pourrait être divisé en deux clans : d’un côté la darksynth puissante, effrénée, dansante et psychédélique et de l’autre celle plus poétique, plus balafrée, plus froide. Ironiquement, cette deuxième catégorie porte mieux les relents de gothique, surtout de « wave », suffixe présent dans le genre plus global de la « synthwave ». Si le premier genre s’acoquine parfaitement au genre cyberpunk, aux néons des dystopies Blade Runner-iennes , aux froides machines et aux night clubs douteux… Le second évolue davantage dans l’horreur, le fantastique, la nuit noire dérangée par la brume et la pluie verglacée. Les deux sont indubitablement liés et se serrent parfois la main, il est difficile de renier que tout le monde n’aimera pas ces deux écoles de la même manière.
Mais revenons-en à GosT, s’inscrivant donc plutôt dans ce deuxième carcan et prouvant une fois encore que les one-man-bands sont des cas passionnants à étudier, car toujours un peu plus intimes et forcément très personnels. On appréciera par exemple « Bound By The Horror » qui, au-delà de l’évidence-même de son nom, propose un revers horrifique dans sa deuxième moitié, rappelant un peu « Carbon Cult » de Deadlife (qui pour le coup semble tout droit sortir d’un slasher !). Le titre de GosT demeure plus brut, plus éraillé et chaotique mais il illustre à merveille ce que j’entends par « darksynth aux relents d’épouvante ». Il est suivi par “The Fear” (difficile de croire que ce n’est pas fait exprès !), et ce dernier est plus classique. Presque trop en vérité, surtout après dix ans de synthwave par des artistes nombreux et parfois très éphémères. C’est dansant et les paroles sont envoûtantes, mais le tout manque d’éclat. « A Fleeting Whisper » vient redresser la barre en alternant entre passages lourds et pesants et moments d’accélérations intenses. Quelques mois à peine après le déjà mythique « Excess » de Perturbator, gageons que de beaux pogos auront lieu sur ce titre ! « We Are The Crypt » quant à lui lorgne davantage du côté de « SKULjammer » de Mega Drive, gros inclassable mélangeant les deux écoles susmentionnées pour mieux les dynamiter de l’intérieur. On retiendra des titres diablement efficaces, entraînants à souhait tout en conservant cette couche d’onirisme vampirique.
Sans sonder tout l’album, soulignons encore « Blessed Be » et son intro à l’orgue mutant en musique d’autoroute nocturne. « November Is Death » est mystique et planant. « Embrace The Blade » rajoute une gratte bien râpeuse à un ensemble presque magique. « Coven » avance encore d’un cran dans la puissance, avec un titre lorgnant cette fois plus franchement dans le Perturbator-like en termes de sonorités, et toujours dans une ambiance « cold wave » avec les paroles. Un hybride fonctionnant à merveille, et sans doute un autre titre qui gagnera à être expérimenté en live. Enfin, « Burning Thyme » vient faire retomber la pression, tout en minimalisme avec juste la voix de James pour nous porter les premiers deux-tiers du morceau, suivi d’un beat à nouveau fort classique pour de la synth, mais qui ne fonctionne pas trop mal pour clore l’album. On aurait tout de même aimé quelque chose d’un peu plus risqué et audacieux pour finir ce chapitre voulu plus sombre et dramatique. On saluera néanmoins la forte tendance à l’excentricité du gaillard. Versatile et changeant, GosT propose une palette étonnante qui varie même au sein d’un album. En bref, ROLAR est un nouvel opus garnissant à merveille la discographie déjà fort fournie de notre sombre poète. Moins punchy et endiablé que le précédent, il le compense par une teinte plus macabre et cauchemardesque. Assurément, la pandémie (entre autres), a dû travailler l’esprit de James Lollar, faisant naître de nouvelles idées sombres. Heureux qu’il continue son bout de chemin, on le sera d’autant plus s’il suit la précédente tendance de sortir deux albums coup-sur-coup (Behemoth et Non Paradisi, puis Possessor et Valediction sont sortis à un an d’intervalle). Fans de macabre, vous voilà servis !
BLACK SWAMP WATER - "Awakening"
Il est assez amusant que la promo de l’album semble se moquer des groupes inventant un « nouveau » genre de toutes pièces, presque par prétention et désir de se forger une identité propre. Ceux-ci défendent alors la musique du quintet danois en expliquant que malgré une apparente simplicité, elle rend des hommages assumés à des groupes comme Black Sabbath ou Corrosion of Conformity, le tout formant un mix de hard rock et de heavy à l’ancienne. Sauf qu’à titre personnel, c’est précisément cela qui me gave bien plus que les groupes essayant bien trop ardemment de se créer un style unique. On pourrait alors pointer une certaine hypocrisie de ma part, sachant que mes chroniques font généralement l’éloge de l’hommage bien fichu et des retours aux sources des groupes punks ou gothiques par exemple. Sauf qu’il faut bien dire ce qui est : ces genres demeurent marginaux et leur âge d’or est loin derrière. Le hard rock comprend toujours nombreux de ses pionniers (dont on jure qu’ils joueront même un pied dans la tombe), mais surtout l’offre était déjà surnuméraire à l’époque et continue à l’être. L’offre de groupes s’inspirant de ces glorieuses années ou des groupes qui les ont fait grandir est également astronomique, et de fait : on finit par s’en lasser quelque peu. Alors même si Black Swamp Water porte ses références à bras le corps, l’enthousiasme n’y est pas : les thèmes, les sons, les titres mêmes sont du vu et revu. Alors oui, il y a bien des notes de Thrash et de Rock Sudiste pour faire varier les plaisirs, tout comme les influences ne s’arrêtent pas à la bande à Ozzy, mais lorgne également du côté d’Alice Cooper et même un brin chez Metallica par exemple. Mais cela ne suffit pas à sauver un album décidément terriblement générique. On ne pourrait pas le qualifier de mauvais, car il est musicalement clean et efficace mais il peine à transcender, à se rendre mémorable. Vite écouté, vite oublié.
CIRCLE OF SIGHS - "Narci"
Voilà encore un groupe qui a choisi la carte de l’anonymat pour porter son bien mystérieux projet. L’originalité est sans doute un peu passée maintenant, mais c’est raccord avec ce que le « collectif » entend proposer. Et pour le coup, que ce soit sur son premier ou sur ce nouvel album, Circle of Sighs étonne totalement en nous transposant dans de multiples réalités, façonnées par des sonorités multiples et des plus surprenantes. Narci apparaît cependant un peu plus lumineux, peut-être un peu plus triste aussi que Salo, qui était largement plus enfoncé dans un Doom poisseux, collant et lugubre. Narci accentue les nappes de synthé, avec même un peu de piano et de cuivres pour agrémenter le tout. Les titres sont parfois un peu plus verbeux aussi, comme « Roses Blue », atmosphérique à souhait, se voulant à la fois mélancolique et trippant. Le titre d’ouverture « Spectral Arms », étonne déjà par sa longueur (avec dix minutes, c’est le morceau le plus long de l’album), mais aussi par sa dualité entre ce piano vanté plus haut, lui conférant une certaine douceur, pour ensuite mieux nous frapper par ses riffs lourds et lents. Rajoutons-y quelques enregistrements vocaux pour agrémenter certains titres, et on se retrouve avec un album plutôt frais, plutôt audacieux et surtout versatile. Une bonne raison de suivre ces mystérieux musiciens masqués de près.
SISTERS OF MERCY TRIBUTE - "Black Waves Of Adrenochrome"
À l’exercice de la cover, il y a généralement deux écoles : celle qui préfère préserver toute l’aura de l’artiste originel en ne touchant pas trop à leur style. Et celle qui, au contraire, choisit un titre pour mieux le tordre et se le réapproprier (il existe une troisième école qui dit que les covers sont pour les groupes fainéants en panne d’inspiration mais il ne faut pas les écouter). Grande chance : cet album-hommage propose les deux, et pour cause : ce sont quinze artistes différents qui se sont essayés à l’exercice, proposant des approches très différentes au sein du domaine particulier de la reprise. Tout ne se vaut pas forcément, mais aucun titre n’est foncièrement mauvais ou inintéressant. Disons plutôt que certains hommages sont plus audacieux et créatifs alors que d’autres sont plus convenus, tout en parvenant à bluffer, sonnant fortement comme le groupe d’origine (évoquons par exemple « Marian » par Columbia Obstruction Box » ou « Lucretia My Reflection » par Dan Swanö). Non, les deux seuls vrais bémols, bien que minimes, sont plutôt la présence de plusieurs titres en doublon comme le mythique « Temple of Love », « More » ou « This Corrosion ». Bien sûr, le résultat n’a rien de totalement comparable, mais on aurait apprécié un projet à la « Dirt Redux », sorti l’année dernière pour commémorer Alice in Chains, où chacun des groupes invités avait proposé un titre unique, ou encore le tout aussi fameux « For The Masses » célébrant Depeche Mode. Ce qui nous amène au deuxième défaut de la galette : presque tous les titres existent depuis plusieurs années (exceptions notables pour Columbia Obstruction Box et Cadaverous Condition & Kara Cephe). Mais là aussi, bien malintentionné sera celui qui se détournera de l’album pour ces raisons : à moins d’être fan absolu du groupe et d’avoir sillonné les tréfonds de YouTube, la plupart des reprises faisaient office de rareté. Et pas seulement parce qu’il est rare qu’une reprise fasse grand bruit, loin de là : entre les titres jamais sortis, ceux de groupes moins reconnus ou tout simplement passés sous les radars, il y a certainement des vieilleries inconnues qui vous attendent. En soit, plus que de plébisciter l’un des groupes les plus célèbres de la scène gothique, ou même de redécouvrir certaines chansons moins connues de leur catalogue, l’idée est plutôt de regrouper sur un même disque ces nombreux hommages, et aussi de sécher nos larmes en nous rendant compte que, si le groupe est bien vivant et actif sur la scène live, il reste silencieux aux prières de fans désireux d’un nouvel album depuis trente longues années. Tant pis… Il faudra encore se rendre en live pour espérer grappiller quelques nouveaux sons. Et pour les autres, « Black Waves Of Adrenochrome » devrait et devra satisfaire votre soif de Sisters of Mercy. Comme quoi, la vie n’est que trop rarement bien faite !
REVENGE OF THE MARTIANS - "A tribute to Uncommonmenfrommars"
En substance, cet album-hommage n’est « rien d’autre » qu’un bon album punk. Mais mieux que cela, il accomplit tout ce que demande un opus de reprises réussit : mélange de morceaux iconiques et plus méconnus, alternance de reprises touchant à peine aux originales et d’autres s’emparant de ces chansons pour mieux les tordre, alternance de titres bourrins et d’autres plus posés… Et on peut en plus rajouter qu’avec un tel panel de noms (un par titre), on nous gratine en plus d’une synthèse de multiples genres de punk, avec les innombrables affreux petits rejetons qu’on lui connaît. Héritiers de la première vague, déconneurs adulescents du pop-punk et même un peu de ska… Nul doute que les plus ronchons trouveront quand même l’une ou l’autre reprise valant bien l’originale par sa créativité ou son énergie. On pourrait s’étonner qu’un groupe n’ayant eu « que » quinze ans de carrière, et ne paraissant pas être une institution punk ni franco-française, ni internationale, se dote de tels éloges en (au moins) deux albums. Mais pour les plus « américains des punks français », j’ai presque envie de dire : justement. Quel intérêt de sortir un best-of d’un groupe mythique dont la réputation n’est plus à faire ? Dès l’instant où l’on peut au contraire afficher à la face du monde ce qu’il a pu rater et qui, alors que la seconde vague américaine avait déjà débuté, jouait un hybride très sympa de vieux et de nouveau punk. Puis bon… Quinze ans dans le punk… C’est pratiquement une carrière entière !
En clair, cet opus n’est pas tant un incontournable qu’une porte d’entrée formidable à la discographie du groupe… même si ce n’est pas lui qui joue dessus ! Les plus fanatiques trouveront quant à eux des versions alternatives de très bonnes factures, dont beaucoup ont été enregistrées par des groupes français en plus ! Comme quoi il est bon de rappeler que même en 2021 : « punk’s not dead » … et ce, pas même en France. Ce n’est là que le premier volume ?? Mais sortez-donc vite le deuxième bon sang !
King Buffalo
Malgré une pandémie rude à plus d’un titre et particulièrement frustrante, le trio derrière King Buffalo n’a clairement pas chômé puisqu’il prévoit non moins de trois albums avant la fin de l’année. Avec un style inclassable et des textes pesants et difficiles, le groupe nous fait part de son spleen, marqué par une période de grands bouleversements. C’est le guitariste et chanteur Sean McVay qui a répondu à nos questions portant autant sur le travail de Beksinski que sur la morosité ambiante découlant de leurs chansons aux titres mystérieux.
Félicitations pour ce nouvel album ! Le premier truc qui m’a surpris en me renseignant sur sa conception est qu’il s’agit vraisemblablement du premier opus d’un trio prévu pour cette seule année 2021. La pandémie vous a inspiré tant que ça ou particulièrement ennuyé ? Que pouvons-nous attendre sur ces albums à venir ? Une sorte de « trilogie » cohérente ou au contraire des titres très différents ? La pandémie a réduit à néant tous nos projets de tournées pour 2020 et il fallait donc trouver une alternative pour rester productif. Comme en plus le nombre d’infections était plutôt bas au sein de notre ville, on a pu se permettre quelques jam sessions… tout en gardant le masque ! On a rapidement accumulé des heures et des heures de nouveau contenu potentiel, ce qui a rapidement fait germer l’idée de produire trois albums pour contenir tout cela. Chacun d’eux aura un style et une ambiance différente, tout en ayant un « scénario » plus global.
Vous vous considérez apparemment comme un projet « heavy psych rock », mais cet album comporte aussi des touches prog marquées. Était-ce un choix délibéré et conscient ou plutôt une évolution naturelle de votre son ? Quel a été votre état d’esprit sur la façon de concevoir l’album ? Je pense que c’était une évolution naturelle. Nous sommes fans de tout type de musique aux relents progressifs, et on tente perpétuellement de nous surpasser et de faire évoluer notre son. Pour l’album, on s’est penché un peu plus sur des rythmes hors du commun ainsi que des sonorités uniques.
J’ai également remarqué que malgré une atmosphère assez inquiétante planant sur la plupart des titres de l’album, chacun des titres « sonne » assez différent l’un de l’autre. « Locusts » paraît presque mystique, tandis que « Hebetation » est plus pêchu avec des riffs et une batterie plus marqués. Comment parvenez-vous à rester cohérent en déployant une telle versatilité ? Hmm… Je dois dire ne pas savoir si on s’en est vraiment préoccupés. On apprécie simplement varier les plaisirs et expérimenter avec des sons nouveaux. Mais au final, ce sont toujours les mêmes mains et les mêmes esprits qui les sortent ! Ce serait difficile de produire quelque chose qui ne sonne pas comme du King Buffalo. On essaye simplement d’avancer sans spécialement se soucier du reste, à moins que cela ne se mette à sonner vraiment bizarre !
Je suppose que la pandémie a également permis un mix intéressant de frustration et de créativité pour tout un panel d’artistes. Vos chansons paraissent assez pessimistes, parfois même nihilistes. Si certaines d’entre elles forment une sorte de poésie noire, un titre comme « The Knocks » paraît carrément dépressif ! Idem pour « Burning ». Êtes-vous attirés par des thématiques plus moroses ? Qu’est-ce qui inspire vos textes ? Est-ce que vous vous sentez bien, personnellement ? Lorsque nous écrivions l’album, j’étais dans une période assez difficile. J’ai eu des soucis familiaux qui trainaient déjà depuis quelque temps, tout en devant vivre avec l’état de plus en plus lamentable et même horrifiant de la culture et de la vie politique américaines… Si on rajoute une pandémie d’ordre mondial et tout cela mis ensemble a pas mal joué sur ma santé mentale. Si j’avais voulu écrire quoique ce soit d’autres lors d’une telle période, le résultat aurait été faux, malhonnête et forcé. Alors j’ai simplement voulu écrire sur ce que j’observais et ressentais. Je suis quelqu’un de plutôt intimiste, donc partager ces sentiments à la face du monde était aussi difficile qu’effrayant. L’album n’est pas qu’une façon de grandir en tant que groupe, mais aussi pour moi, à titre personnel. L’expérience fut très cathartique.
Puisque j’évoquais « The Knocks », elle paraît avoir quelques congruences avec « Silverfish », notamment dans leurs sonorités. Était-ce une manière consciente de les connecter ? Oui. Ces deux chansons prennent place dans l’esprit du protagoniste de l’album. Elles ont la même tonalité et utilisent un effet similaire au niveau de la guitare, afin de les placer dans le même « contexte ». « The Knocks » est la pleine continuation de « Silverfish ».
Les titres de vos chansons sont également plutôt cryptiques, parfois même obscurs. J’ai écouté l’album trois fois et j’admets ne toujours pas comprendre pourquoi « Locusts » ou « Loam » par exemple. Sans nous donner toutes les clés, pouvez-vous nous expliquer comment un titre se rattache au contenu d’un morceau ? Comment choisissez-vous leurs noms ? Et bien, je ne veux pas en dire trop justement, pour éviter de forcer une interprétation plutôt qu’une autre ! Je dirai que pour « Locusts », on évoque l’idée d’une force écrasante, agissant comme une peste accablant les gens qu’elle est supposée servir. « Loam » est un synonyme de « soil » (ndlr: "souiller"), et c’est un aspect crucial de cette chanson. Trouver des noms pour un morceau est toujours un procédé particulier, et c’est généralement ce que l’on fait en dernier. En fait, la plupart de nos chansons n’ont même pas de titre finalisé lorsque nous nous accordons sur le titre de l’album ! En général, je préfère trouver un titre provisoire qui annonce la couleur du morceau… et ce dernier fait le reste, imposant de lui-même le titre final.
J’ai pu comprendre au fil d’interviews que tout le monde n’aime pas forcément parler en termes de « genres » et choisissent au contraire de simplement faire ce qu’ils ont envie de faire. Néanmoins, j’avoue avoir été un peu surpris en entendant des paroles, du texte en lançant l’album ! Le côté prog ou un peu post-rock m’a habitué à une place plus secondaire des paroles. Disons que votre musique pourrait sans doute s’écouter sans elles, mais ce n’est pas du tout une critique ! La voix plus douce et grave rajoute un côté plus « chaleureux » malgré vos thématiques difficiles. Est-ce que les paroles étaient planifiées d’emblée ? Est-ce que vous considérez que vos titres seraient « diminués » sans elles ? J’adore la musique instrumentale, mais je pense qu’avoir des paroles aide à avoir un effet plus structurant, plus lisse. Les paroles « guident » l’auditeur et permettent un scénario plus clair, plus profond. Je ne dirai pas que nous misons tout là-dessus en tant que groupe, mais cela reste un élément important de notre musique. Après, je suis le chanteur…donc, prenez ça avec des pincettes ! [rires]
Un petit mot sur l’artwork : il impressionne d’emblée, et j’ai immédiatement reconnu la patte de Zdzisław Beksiński ! Pourquoi avoir choisi cet artiste et cette toile en particulier ? Qu’est-ce qu’elle raconte sur l’album ? C’est Scott, notre batteur, qui nous a suggéré de nous pencher sur le travail de Beksiński pour la pochette de l’album. C’est un grand fan et c’est lui qui nous a fait connaître l’artiste, dont nous avons fini par égrainer chaque peinture. On était très impressionnés ! L’image que nous avons choisie paraissait englober la thématique et le feeling de l’album parfaitement.
Évoquons brièvement le clip que vous avez sorti récemment. J’ai plusieurs questions à son sujet : premièrement, pourquoi avoir choisi « Silverfish » pour cet exercice ? Est-ce que d’autres vidéos sont prévues pour la sortie de l’album ? Et ce monochrome est plutôt stylé aussi ! Il convient bien au ton sombre et mélancolique de l’album… Est-ce la raison de son utilisation ? Aviez-vous, en tant que groupe, beaucoup de libertés créatives au moment de réaliser le clip ? Nous avions la sensation très tôt lors de l’enregistrement que « Silverfish » avait le potentiel d’être super cool, et que le titre passerait super bien en tant que single. Pour le clip par contre, nous n’avons pas eu beaucoup d’influence sur sa création. On a demandé de l’aide à Mike Turzanski, un artiste et ami que nous estimons beaucoup, et c’est lui qui a élaboré tout le concept et les visuels du clip. On lui a pleinement fait confiance, on savait qu’il pouvait se lâcher, même en ne sachant pas exactement à quel résultat s’attendre. Il nous a simplement envoyé la première ébauche de vidéo après avoir filmer nos scènes, et on était convaincus. Le résultat nous convient parfaitement !
À propos du scénario lui-même, on peut voir la tête et le visage de notre protagoniste se couvrir progressivement de plus en plus de « nerfs », en même temps que le tempo de la chanson s’accélère et devient plus fort et bruyant. Est-ce une façon d’afficher visuellement et auditivement qu’une situation vous rend de plus en plus fou ? « Staring at the cracks in the wall » (ndlr: "regarder les fissures dans les murs") ressemble à quelque chose que l’on a tous du faire lors de cette pandémie ! Comme je disais plus haut, je n’étais pas au top de ma forme lors de l’enregistrement de l’album. J’ai eu l’impression de m’éteindre en quelque sorte, de me réfugier dans mon for intérieur. Et même si chacun à ses propres raisons de se sentir comme cela, je me suis dit que cette sensation devait être assez universelle, au point de permettre à d’autres de se retrouver au sein de la chanson.
J’ai pu remarquer qu’une nouvelle tournée était déjà prévue pour vous. Elle débute dès septembre si je ne dis pas de bêtises ? J’imagine que le public a dû vous manquer ! Qu’est-ce qui les attend, maintenant que vous avez la possibilité de vous produire à nouveau ? Je pense que je peux m’exprimer au nom de tout le groupe en disant qu’on est plus qu’impatient de retrouver les salles. C’est le délai le plus long que nous avons connu entre deux concerts en treize ans. Notre premier concert de reprise va certainement nous paraître très spécial.
J’ai aussi vu que vous aviez proposé plusieurs « lockdown sessions » pendant la pandémie. Même si cela ne remplace bien sûr pas un vrai concert, était-ce une activité qui vous a plu ? Comment les fans ont-ils réagi ? Le succès était au rendez-vous ? Oui, les retours que nous avons eus étaient phénoménaux ! On a reçu un feedback très positif, aussi bien de nouveaux que d’anciens fans.
La pandémie s’est beaucoup invitée dans cette interview et de nombreuses autres, mais est-ce qu’elle a eu un impact « pratique » dans la conception de l’album ? Vous nous avez dit qu’elle vous avait inspiré thématiquement, mais est-ce que le processus d’enregistrement fût bouleversé aussi ? Le processus était clairement différent. Comme je l’évoquais, au début, nous avions la possibilité de nous retrouver avec quelques précautions minimes, car les chiffres liés au COVID étaient bas de notre côté. Mais après quelque temps, le risque paraissait devenir non nécessaire alors que nous avions la possibilité de travailler à distance. Généralement, je taillais dans diverses idées avant de les envoyer aux autres, puis nous répétions chacun séparément. Idem lors de l’enregistrement : nous nous sommes occupés chacun de notre partie individuellement. Lors des finitions, il n’y avait que moi (puisque je suis aussi l’ingénieur du son et producteur du groupe) et alors soit Dan ou Scott. Mais puisque les choses reviennent petit à petit à la normale, on a pu à nouveau se voir tous ensemble et en personne pour l’enregistrement des albums deux et trois. C’est quand même bien mieux !
Enfin, je me souviens d’un concert joué à l’Ancienne Belgique en 2018. Avez-vous des souvenirs du public belge ? Est-ce qu’un nouveau concert dans notre pays vous paraît plausible ? Le public était fantastique et la salle incroyable. Le son surtout était impeccable, tandis que les fans étaient très accueillants… et nous ont permis de tester de super bières belges bien sûr. C’est toujours assez difficile de planifier quoique ce soit en Europe pour le moment, mais je suis sûr qu’on finira par revenir en Belgique très bientôt.
TWO TRAINS LEFT - "As Safe As Yesterday"
Je l’avoue : je suis passé par un grand enthousiasme et son contraire en zieutant les infos liées à ce jeune groupe parisien. En repérant « punk » et « français », je me suis mis bien sûr à imaginer un hommage nostalgique aux groupes mythiques du genre comme Les Shérifs ou Parabellum. Puis à la vue de « pop punk à l’américaine », c’est plutôt un frisson qui m’a courbé l’échine : si le genre paraît sans doute moins ringard à la génération à laquelle j’appartiens, il s’est aussi plus rapidement essoufflé, semblant avoir tout dit aux portes des années 2000. Mais le résultat est, finalement et heureusement, plutôt dans l’entre-deux : oui on est sur du pop-punk assez classique et référencé, mais le résultat est fait avec plein d’énergie et de bonnes intentions. Il y a bien sûr certains éléments avec lesquels j’ai désormais un peu plus de mal, notamment les thématiques toujours très adulescentes et tournant souvent autour de l’amour blessé et du mal-être. Pas de chance : l’EP en est truffé. Mais il s’agit d’un défaut, somme tout, subjectif. Qui plaira sans doute à un public moins lassé par ce type de textes larmoyants. Musicalement parlant, par contre, aucune réelle raison de se plaindre tant le groupe mise sur de l’adrénaline et du speed qui ne rechignerait pas à apparaître dans un jeu vidéo sorti en début-2000 (il s’agit souvent d’un mètre étalon pour qualifier le pop-punk à la saveur nostalgique et vivifiante !). Et nul doute qu’il s’agit là d’une des inspirations du groupe également, tant leurs codes semblent tributaires des pionniers (jusqu’au nom de leur album et du groupe d’ailleurs… L’illusion est parfaite !). Et c’est sans doute comme cela que l’on pourra les résumer au mieux : en guise d’offre pop-punk, le cahier des charges est plus que rempli ! Les jeunes Parisiens peuvent se targuer d’émuler mieux le panthéon américain que certains groupes US eux-mêmes. Je n’en suis pas client à outrance, j’ai passé cette période pour aller dans le recueil plus ouvertement politique ayant précédé le raz-de-marée pop-punk. Mais il serait injuste de les pénaliser pour des raisons aussi puériles et personnelles. Ce qu’ils font, ils le font bien et avec un peps d’enfer. Pour les amoureux du genre : régalez-vous ! Et pour ceux qui veulent retrouver leur jeunesse pendant une vingtaine de minutes, écoutez-les aussi !
EXORCIST - "Nightmare Theatre"
Si je dois être tout à fait franc, j’ai cru que j’allais tomber sur le groupe polonais du même nom en choisissant cette ressortie de l’unique album d'Exorcist. En effet, les deux groupes sont nés dans les années 1980, les deux font du thrash, et les deux n’ont sorti qu’un unique album. La différence étant que les Polonais ont sorti le leur assez récemment (en 2014… Tout de même vingt-huit ans après leur formation !) tandis que l’Exorcist qui nous intéresse ici a sorti un CD en 1986, l’année de leur formation, avant de directement se séparer… Et pour cause : il s’agit en fait d’un projet annexe des gars de chez Virgin Steele, un audacieux one-shot qui sort totalement des sentiers battus. Pour l’anecdote, cette même fine équipe a sorti la même année le seul album d’un groupe dénommé « Original Sin » qui, sous couvert d’un quatuor de femmes, a en fait été écrit et enregistré par les mecs de Virgin Steel… Une sacrée histoire qui mériterait d’être approfondie ! Et c’est totalement pour ce genre d’idées saugrenues que j’adore le monde de la musique. Mais pour l’heure, tâchons de savoir si "Nightmare Theatre" vaut le coup.
Et bien tout d’abord, il est important de noter deux choses : la première est qu’il s’agit assurément d’un concept-album. La thématique est sombre et macabre, et se place comme un évident hommage au film de William Friedkin (et aux nombreux clones qui l’ont suivi, sous fond de possession démoniaque et de châtiments divins). Le concept est un peu éculé aujourd’hui, mais à l’époque et surtout dans le thrash, ce n’était guère commun. La deuxième est qu’il y a de gros éléments de black dans la galette, en bon contemporain de Venom qui sévissait depuis une paire d’années. Cela va bien entendu des thèmes abordés à la voix choisie. Sachant qu’encore aujourd’hui, les groupes de black thrash ne sont pas la norme, et les bons groupes encore moins, c’est tout de même plutôt plaisant. D’autant plus provenant d’un groupe si éphémère aux membres n’ayant pas forcément la réputation d’opérer dans ce registre.
Là où le bât blesse cependant, c’est dans la construction, la structure des morceaux. Celles-ci sont généralement plutôt efficaces et bien fichues, rien à redire sur leur qualité intrinsèque. Ce qui est plus gênant, c’est qu’elles se ressemblent beaucoup, au point de lasser au point de 3-4 titres répétant la même formule. Et même si je suis généralement assez client des refrains simples, mais entraînants… Difficile de ne pas froncer les sourcils quand la quasi-totalité de ceux-ci se résume à gueuler le titre du morceau en boucle. C’est dommage parce que sur les interludes, il y a quelques bonnes idées d’ambiance, de « mise en scène ». Que ce soit le feu qui crépite sur « Consuming Flames of Redemption » ou les voix qui s’élèvent lors du procès de « The Trial ». Et que dire alors de la chanson « Spin Your Head Around Backwards » qui n’est pas seulement une évidente référence à la scène la plus mythique du film susmentionné, mais aussi une idée stupidement géniale d’inverser les paroles et l’instru ! Cela en fait un titre pas forcément agréable à l’oreille, mais dont l’idée épate, assurément.
En bref, cet album n’a rien d’incontournable musicalement parlant. Il a quelques bonnes idées et des titres qui valent leur pesant de cacahuètes, mais rien qui ne transcendera le fan aguerri de thrash. Ce qui le rend vraiment intéressant, c’est finalement davantage son background et sa thématique poussée à fond. Parfois, c’est nettement plus que ce à quoi on s’attend de la part d’un album. Il mérite son écoute, quitte à ce qu’il retourne dans les limbes du temps une fois cette expérience particulière ressentie !
NEIL MERRYWEATHER AND THE SPACE RANGERS - "Space Rangers"
Cette ressortie d’album ne pouvait que difficilement mieux tomber, avec le décès en mars dernier du très productif, créatif et éclectique Neil Merryweather. Actif pendant plus de cinq décennies, plutôt avant-gardiste, flirtant avec le gratin des 70s tout en continuant son bout de chemin au point de sortir encore quatre albums entre 2018 et 2020, l’album « Space Rangers », l’un de ses plus connus, et issu de sa période la plus riche et fastueuse. De quoi en faire un hommage parfait, pour un artiste souvent éclipsé par ses contemporains.
Première pensée en finissant l’album : le space rock, ça avait tout de même du bon. C’est dommage que la fantasy soit toujours aussi populaire dans le rock et assimilé (surtout dans le heavy, le folk et le power, soyons francs) alors que la science-fiction semble être restée au siècle dernier, même si ça englobe tout de même au moins quatre décennies entre les années 1950 et 1990. On a bien la synthwave et ses sous-genres pour nous faire un peu rêver de machines et d’extraterrestres, mais cela s’arrête ici. Heureusement, Merryweather et sa bande sont là pour nous rappeler qu’il y a une époque pas si lointaine où les étoiles et le cosmos étaient encore en vogue pour nous faire rêver. Avec un goût aujourd’hui kitsch qui à l’époque devait être le summum de la technique et du bruitage. On parlerait aujourd’hui de « neo-retro » pour qualifier ce qui s’apparente à la bande-son d’un film familial un peu cheapos prenant pour cadre l’espace.
Seconde pensée : les albums composites sont tout de même vachement bien. Tant pour découvrir un artiste que pour explorer de nombreuses facettes et ne jamais succomber à l’ennui. Un peu cliché ? Peut-être, mais c’est tellement agréable d’écouter la première moitié de l’album et d’avoir l’impression de ressentir des émotions contrastées et des atmosphères, voire des scénarii sans vrais liens entre eux, si ce n’est l’esprit fantasque de leur créateur. On comprendra que certains préfèrent les albums avec un début et une fin, dont les morceaux forment un tout cohérent et qui s’enchaînent avec aisance. A titre personnel, la préférence va au contraire aux albums surprenants, qui peuvent partir dans un sens puis dans l’autre. J’en prends pour exemple le titre ouvrant le disque : « Hollywood Blvd » et son parfum de mélancolie. Il est suivi directement par le nettement plus positif « Step In The Right Direction » dont les paroles semblent donner une leçon de vie accompagnée d’instruments résolument funky … S’en suit « Eight Miles High », aux relents plus psyché avec une basse survitaminée. « King of Mars » rajoute un côté mélancolique, mais davantage typé ballade, et semble tout droit sortir de l’album « Sad Wings of Destiny » de Judas Priest… alors qu’il est de deux ans son ainé ! Sa montée en puissance et son bridge sont particulièrement savoureux. Autre comparaison ? Le titre suivant « Neon Man » fait penser à The Who, et plus particulièrement l’intro mythique de « Baba O’Riley ». On ne va pas tous les faire, mais l’essentiel c’est que chaque titre apporte sa pierre à l’édifice et permet d’avoir un album où chaque titre peut avoir le pouvoir de vous captiver, même si les deux précédents n’ont pas fait mouche.
Cette critique demeure très éparse et je m’en excuse. Mais il fallait bien ça pour rendre justice à un album qui lui aussi est très polymorphe. À la fois profondément ancré dans son époque et manquant terriblement aujourd’hui. Et qui rajoute le parfum un peu triste de l’hommage imprévu, de l’ultime cadeau d’un artiste que l’on découvre bien trop tard. Mais comme le dirait si bien mon paternel : « peu importe l’âge d’une œuvre, elle paraitra toujours neuve lorsqu’elle nous était jusque-là inconnue ».